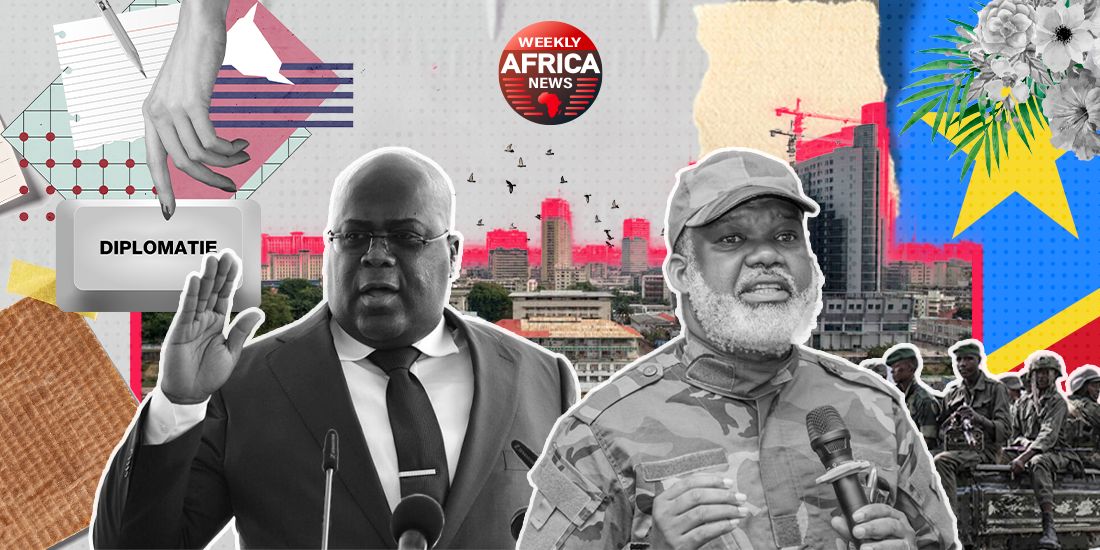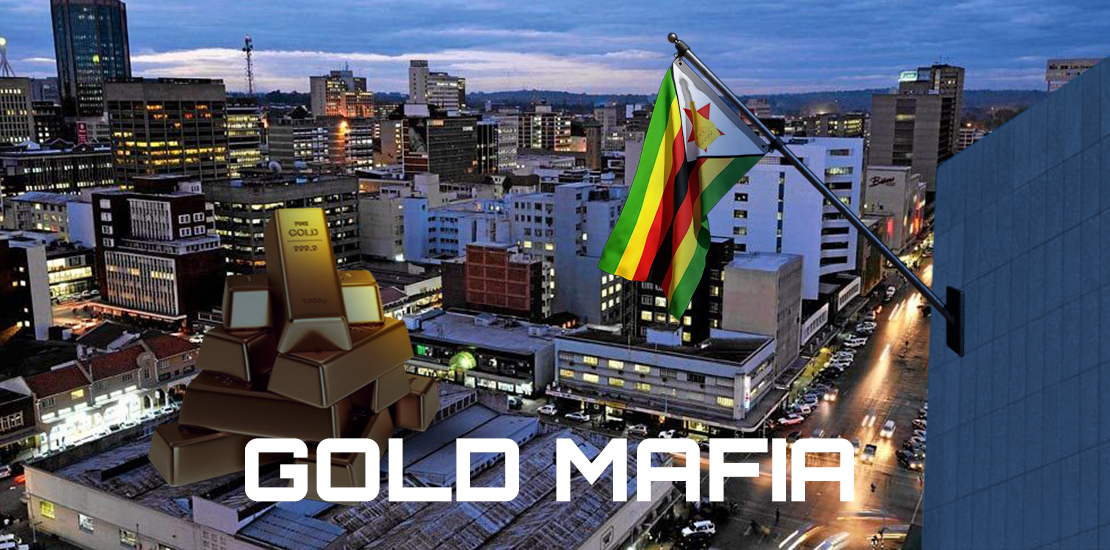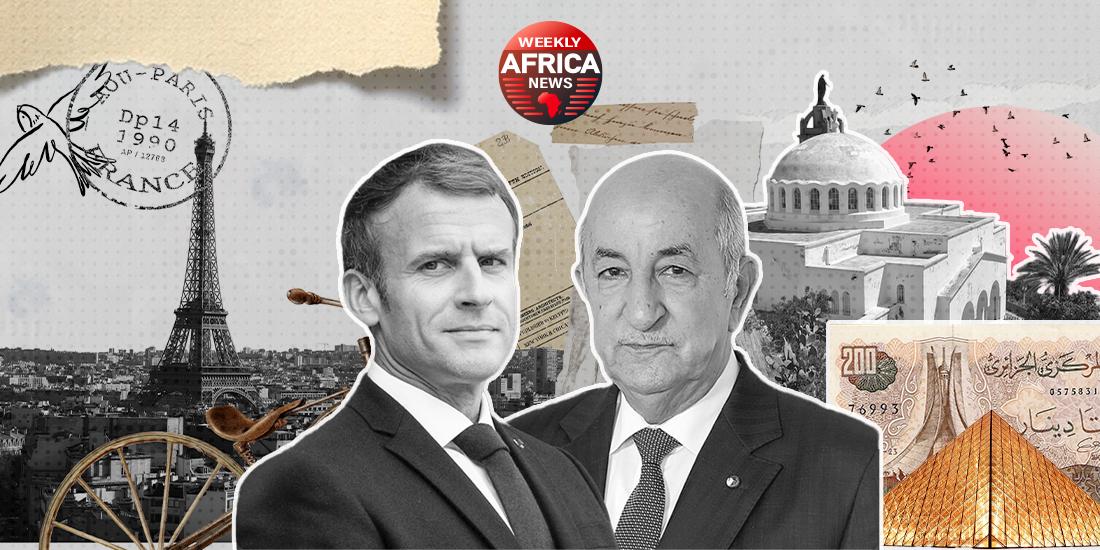Agrobusiness au Sénégal : Pourquoi les promesses de Faye et Sonko peinent à convaincre ?
Dans le sillage des guerres oubliées et des frontières poreuses, l’orpaillage du Sahel est devenu un théâtre discret où se nouent des alliances d’intérêt entre groupes armés, sociétés de sécurité privées et opérateurs miniers formels ou informels. Au cœur de cette économie souterraine, l’or, facilement extractible, aisément transportable, rapidement monnayable, finance la sécurité autant qu’il l’insécurise. L’enjeu n’est pas seulement criminel : il reconfigure les équilibres politiques et les trajectoires économiques de la région.
Dans les zones rurales du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la réalité documentée par des rapports onusiens et des organisations spécialisées converge : des acteurs armés « privatisent » la sécurité des sites aurifères, perçoivent des taxes, ou contrôlent la logistique, du carburant au mercure. Des estimations onusiennes ont chiffré les revenus tirés de ces « services de sécurité » dans le nord du Mali, en marge de l’orpaillage, à plusieurs dizaines de millions de dollars par an. À l’autre bout de la chaîne, l’or ainsi « blanchi par le transit » alimente les marchés du Golfe et de l’Asie, via des hubs de raffinage qui absorbent des centaines de tonnes d’or africain, brouillant la frontière entre flux licites et illicites. En miroir, certains États sahéliens reconfigurent leurs cadres juridiques et coercitifs sans pour autant tarir l’économie grise qui irrigue les périphéries.
Sur le terrain, l’architecture est souvent la même. D’abord, l’« assainissement » d’un site par une force armée, qu’elle soit une milice communautaire, un groupe jihadiste, une coalition de signataires d’accords locaux, ou des contractants privés opérant à la demande d’acteurs politico-militaires. Ensuite, la mise sous régie : péages à l’entrée des carrières, pourcentage sur l’or extrait, monopole de la vente de carburant et des explosifs artisanaux, sécurisation des pistes d’approvisionnement, revente de l’or à des négociants « captifs ». Enfin, l’intégration à des circuits marchands régionaux où l’or change de statut plus vite que d’étiquette. Le résultat est un cycle de dépendance : les mineurs paient la sécurité qui leur permet de travailler ; le paiement renforce les groupes armés ou les sociétés mandataires ; et cette force consolidée verrouille durablement le site.
Au Burkina Faso, dans les zones d’orpaillage de l’est et du sud, des mineurs racontent comment des hommes en armes ont « changé les règles », autorisant l’exploitation dans des réserves contre une dîme en or ou la vente exclusive à leurs courtiers. « On les appelait nos maîtres », confie un orpailleur, décrivant des puits « pleins de combattants » qui « contrôlaient tout ». Ailleurs, au nord du Mali, des témoins décrivent des « tombolomas » (des gardiens armés organisés) ou des milices de chasseurs (dozos) qui monnayent l’accès aux filons. Ces fragments d’oralité se rejoignent : la sécurité devient une marchandise, et l’or, sa devise.
Côté « sécurité », le spectre est large. Les sociétés privées mandatées par des opérateurs industriels sécurisent des périmètres et des convois, parfois en complément des forces publiques. Des milices d’autodéfense locales capitalisent sur leur ancrage communautaire pour devenir des prestataires de fait, encaissant des droits de passage ou des redevances en nature. Les groupes jihadistes alternent coercition et services : ils interdisent l’alcool, régulent les « transactions », taxent l’extraction et sécurisent les pistes, gagnant une base sociale autant qu’une caisse de guerre. Enfin, la galaxie des sociétés militaires privées étrangères, plus visibles depuis 2021-2022, s’inscrit dans des « échanges sécurité-ressources » : assistance armée contre accès à des gisements, concessions ou parafiscalité. Le modèle est mieux documenté en Centrafrique ; au Sahel central, il prend forme via des arrangements opaques, parfois contestés au sein même des appareils sécuritaires nationaux.
La montée des juntes au Mali, au Burkina Faso et au Niger a accéléré une double inflexion : recentrage souverain sur la rente minière (nouvelles redevances, contrôles étatiques renforcés, suspension de certains permis artisanaux) et diversification des partenaires sécuritaires, au détriment des dispositifs onusiens et occidentaux. Le pari est clair : convertir plus rapidement l’or en liquidités budgétaires et en appuis sécuritaires. Mais l’effet induit est connu : l’affaissement des garde-fous (audit, traçabilité, contrôle des exportations) crée un appel d’air pour les opérateurs les moins scrupuleux, accroissant la prime au risque plutôt que l’investissement productif.
Pour les mineurs et les riverains, l’« économie de la protection » ponctionne des revenus déjà précaires, alimente les violences intercommunautaires, banalise le travail des enfants et l’exposition au mercure. Pour les États, la fuite de valeur (sous-déclaration, contrebande, sous-facturation) obère des recettes fiscales essentielles et nourrit des circuits financiers illicites. Pour la région, elle entretient un conflit à bas bruit : l’or finance ceux qui prétendent sécuriser les mines contre d’autres prédateurs, prolongeant indéfiniment le besoin de « protection ». La communauté internationale, elle, se heurte à la plasticité des réseaux : chaque renforcement d’un maillon (raffineries, compagnies aériennes, transit douanier) déplace les flux vers un autre.
Trois leviers se dégagent. D’abord, la formalisation intelligente de l’orpaillage : délivrance de titres collectifs, encadrement des intermédiaires, achats publics pilotes, refineries régionales sous supervision, et guichets de crédit qui coupent la dépendance aux bailleurs criminels. Ensuite, la traçabilité extrarégionale : durcissement des normes KYC des raffineries et des banques négociantes, interopérabilité des registres d’exportation, contrôle des écarts miroirs (Comtrade, Douanes) et sanctions ciblées contre les « courtiers de sécurité » qui blanchissent l’or. Enfin, la démilitarisation graduelle des sites : substituer, autant que possible, des forces publiques contrôlées et auditées aux prestataires armés privés et aux milices, avec des clauses strictes de droits humains dans tout contrat de sécurisation minière.
Le Sahel ne manque ni d’or ni d’expertise. Il manque de confiance institutionnelle et d’incitations alignées. Tant que la sécurité restera un service vendu à la tonne extraite, l’or continuera d’acheter des fusils et les fusils d’acheter l’or. Rompre ce cercle suppose de re-politiser la question : faire de l’orpaillage un enjeu de politique publique plutôt qu’un simple dossier « sécuritaire » externalisé à des acteurs dont l’intérêt est que le feu couve sans jamais s’éteindre.