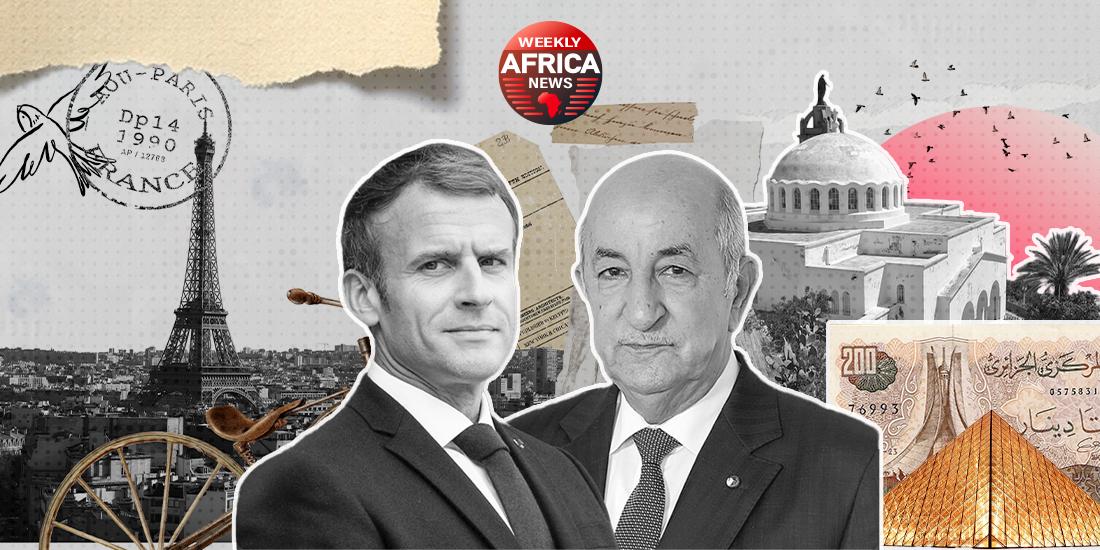Agrobusiness au Sénégal : Pourquoi les promesses de Faye et Sonko peinent à convaincre ?
Dans les capitales d’Afrique de l’Ouest, les rubans ont été coupés pour des ponts, des routes, des ports et des barrages financés par la Chine. Mais derrière ces infrastructures visibles, une autre réalité se joue dans les annexes contractuelles : clauses de confidentialité, collatéraux en devises, comptes séquestres et options d’exécution qui rendent les accords difficiles à examiner. Ces « contrats fantômes » (invisibles au public et parfois au parlement) minent la transparence budgétaire, renchérissent les coûts et compliquent, des années plus tard, toute restructuration de dette.
Le mécanisme est désormais bien documenté. Les contrats de prêts accordés par des banques politiques chinoises recourent souvent à des clauses de non-divulgation étendues, à des comptes de garantie offshore et à des engagements dits « no Paris Club », qui placent le prêteur au-dessus des créanciers traditionnels. En pratique, cela signifie que des recettes publiques peuvent être prioritairement affectées au service de ces dettes, sans que l’information soit pleinement ventilée dans les documents budgétaires. Cette opacité décale le débat démocratique du moment de la signature au moment, plus douloureux, où il faut renégocier.
La Guinée illustre les promesses et angles morts de ce modèle. Le barrage de Souapiti (450 MW), adossé à un prêt préférentiel d’environ 1,2 milliard de dollars, a ajouté une capacité stratégique au réseau national. Mais son financement est associé à des exigences de trésorerie en compte séquestre et à un profil de dette significatif pour un État à la base fiscale étroite. Surtout, le projet a déplacé des milliers de personnes, selon des organisations de défense des droits, révélant le coût social d’une exécution rapide où la transparence foncière et les compensations deviennent des variables d’ajustement. En arrière-plan, un cadre plus large lie depuis 2017 des infrastructures guinéennes à des recettes minières : utile pour lever des fonds, mais risqué si les prix des matières premières fléchissent ou si les recettes ne couvrent pas les échéances comme prévu.
Au Nigeria, l’empilement d’actifs financés par la Chine est spectaculaire : la modernisation ferroviaire Abuja-Kaduna a été soutenue par un prêt concessionnel de 500 millions de dollars ; la liaison Lagos-Ibadan a mobilisé plus de 1,2 milliard ; et le port en eau profonde de Lekki a obtenu un financement bancaire chinois substantiel en plus d’investissements privés. En 2020, une controverse a éclaté autour d’une clause de « renonciation limitée à l’immunité souveraine » dans un accord de prêt, clause juridiquement classique pour l’exécution arbitrale, mais politiquement inflammable. Elle a mis en lumière le point faible de ces grands chantiers : des conditions techniques peu débattues en amont qui deviennent des sujets de souveraineté en aval. Parallèlement, l’encours bilatéral du Nigeria vis-à-vis de la Chine reste modéré au regard de sa dette totale, ce qui n’empêche pas l’exposition croissante d’actifs stratégiques (rails, routes de dégagement de Lekki) à des financements dont les modalités exactes ne sont pas toujours publiées.
Autre cas d’école : la Sierra Leone. En 2018, le gouvernement a annulé un projet d’aéroport neuf financé par la Chine, jugé économiquement injustifié alors que l’aéroport existant était sous-utilisé. L’épisode démontre que les États conservent une marge d’agence réelle : ils peuvent renoncer à un crédit lorsque les coûts à long terme, budgétaires et d’exploitation, excèdent les bénéfices. Mais il rappelle aussi que la visibilité des analyses de « value for money » au moment de la signature constitue la meilleure assurance contre des volte-face coûteuses.
Au Sénégal, le pont à péage de Foundiougne, long de 1,6 km, a désenclavé le bassin du Saloum. Son montage par des entreprises chinoises, appuyé par un prêt concessionnel, témoigne du savoir-faire d’exécution et de l’attractivité de ces financements pour des États confrontés à d’immenses besoins. L’enjeu, ici, n’est pas l’utilité de l’ouvrage mais la reproductibilité d’un standard : publication proactive des termes, audits indépendants a priori, et évaluation rigoureuse des risques d’exploitation à long terme.
La Gambie met le doigt sur un autre risque : celui de la passation. Le projet d’extension du port de Banjul a été envisagé avec un financement concessionnel chinois substantiel. Mais des autorités nationales ont contesté la légalité d’une attribution sans appel d’offres ouvert, soulignant le danger d’une « procédure unique » pour des contrats de plusieurs centaines de millions : sans concurrence, les prix unitaires grimpent, la maintenance est sous-budgétée et la renégociation devient la norme. Ce sont les portes d’entrée classiques des surfacturations et des rétrocommissions : difficilement détectables ex post, elles prospèrent là où la donnée contractuelle est absente ou verrouillée.
Au-delà des cas, les incitations économiques sont claires. Côté chinois, ces projets offrent des carnets de commandes à des entreprises d’État, un ancrage logistique régional (ports, corridors) et des sécurités de remboursement supérieures à la moyenne via des collatéraux et des comptes séquestres. Côté africain, ils comblent un déficit d’infrastructure que les bailleurs traditionnels financent plus lentement. Mais l’arithmétique globale pose question : sur 2000-2023, l’Afrique a engagé plus de 180 milliards de dollars de prêts chinois, concentrés sur l’énergie et le transport. À l’échelle d’économies dont les recettes fiscales se comptent parfois en dizaines de milliards, la soutenabilité dépend alors du coût total du cycle de vie (construction + exploitation + maintenance) et de la flexibilité des clauses en cas de choc.
La question de la restructuration cristallise ces tensions. Au Ghana, l’accord conclu avec les créanciers officiels, Chine comprise, a montré qu’on peut trouver un terrain d’entente. Mais des clauses de priorité de paiement et de collatéralisation, fréquentes dans les contrats chinois, rendent l’exercice plus technique : elles exigent des arbitrages minutieux sur le « traitement comparable » entre créanciers, et des divulgations que ces contrats proscrivent souvent. Tant que ces termes resteront opaques, les ajustements macroéconomiques pèseront davantage sur la dépense sociale que sur l’optimisation des portefeuilles de dettes.
Que faire pour sortir de la zone grise ? Cinq garde-fous s’imposent : (1) publier systématiquement les contrats et annexes, y compris les dispositions de collatéral et les ententes de séquestre ; (2) interdire les clauses de confidentialité qui empêchent l’information du parlement et de la cour des comptes ; (3) imposer la mise en concurrence pour les EPC au-delà d’un seuil et publier les ingénieries de coûts unitaires ; (4) réaliser des audits « value for money » indépendants avant décaissement ; (5) renforcer l’outillage des commissions parlementaires (budgets, infrastructures, finances) pour un contrôle continu. À défaut, les « contrats fantômes » continueront d’alourdir les bilans publics, loin des projecteurs braqués sur les inaugurations.
La Belt & Road n’est ni un piège inévitable ni un miracle financier. C’est un marché d’infrastructures qui, sans transparence, produit une illusion d’abondance aujourd’hui et des factures invisibles demain. La bataille n’oppose pas financements chinois et occidentaux ; elle oppose l’opacité à la redevabilité. Et c’est sur ce terrain que se jouera la soutenabilité des ponts, des ports et des barrages qui redessinent l’Afrique de l’Ouest.