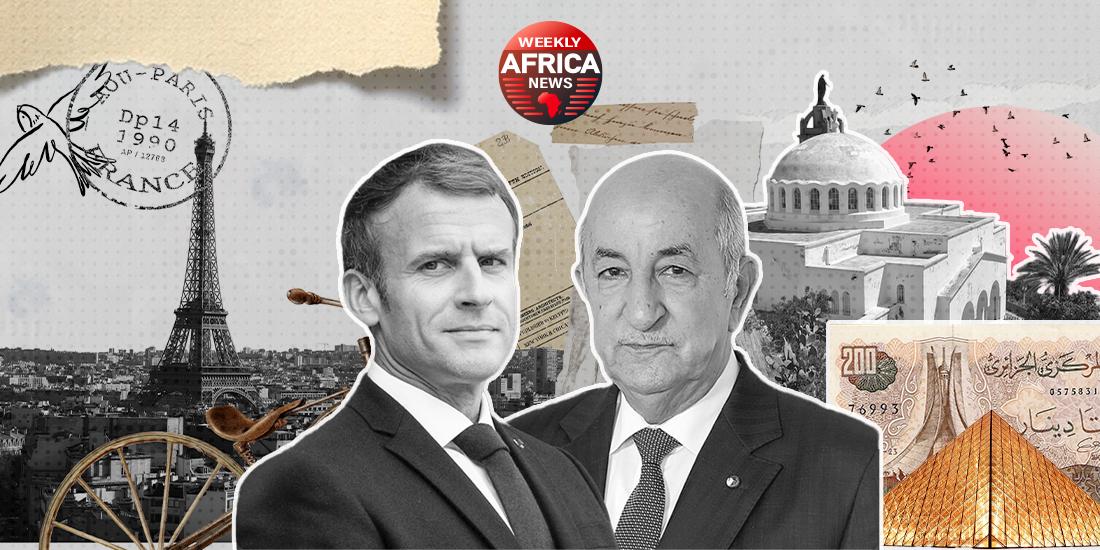Agrobusiness au Sénégal : Pourquoi les promesses de Faye et Sonko peinent à convaincre ?
Au Togo, le coton, longtemps présenté comme un « or blanc », traverse une zone de turbulence où s’entremêlent intérêts publics, stratégies privées et interventions des bailleurs. Alors que la production de coton graine a reculé à 60 403 tonnes en 2024-2025, les pouvoirs publics maintiennent un prix d’achat à 300 F CFA le kilo et des engrais subventionnés à 14 000 F CFA le sac. Derrière ces chiffres, un système d’approvisionnement en intrants et d’organisation de la filière qui concentre les pouvoirs aux mains de quelques acteurs, et soulève des questions de transparence et de conflits d’intérêts.
En 2020, le groupe singapourien Olam a acquis 51 % de la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT), la société pivot qui achète le coton graine, approvisionne les producteurs en intrants et organise l’égrenage. L’État et la fédération des producteurs conservent des parts minoritaires. Cette prise de contrôle s’inscrit dans une stratégie plus large de transformation locale via la Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA), un partenariat public-privé porté par Arise Integrated Industrial Platforms pour développer une chaîne textile « de la fibre au vêtement ». Historiquement, Arise IIP a été liée à Olam avant une recomposition de son actionnariat. Même si ces liens ont évolué, l’articulation NSCT-PIA a, dès l’origine, posé une question simple : quand le principal acheteur de coton et distributeur d’intrants est connecté à la zone industrielle chargée d’absorber et transformer la fibre, qui arbitre l’intérêt général (prix, qualité des intrants, calendrier des livraisons) ?
La NSCT achète et distribue engrais, herbicides, insecticides et semences aux groupements de producteurs, avec des prix administrés et des subventions publiques. En parallèle, la Centrale d’Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles (CAGIA) gère les engrais pour les cultures vivrières. Le Togo reste largement dépendant des importations : en 2022, plus de 114 000 t d’engrais ont été importées (principalement NPK et urée) ; en 2023, environ 109 000 t. Un tissu local de mélange existe mais l’outil industriel demeure modeste au regard des besoins. Le gouvernement annonce la création d’unités supplémentaires et la valorisation du phosphate national pour produire des engrais, avec des partenariats en cours. À court terme, la dépendance extérieure demeure, comme l’illustrent des négociations avec des acheteurs étrangers de roche phosphatée et des discussions régionales pour sécuriser les approvisionnements.
Sur le papier, les garde-fous existent : appels d’offres internationaux pour les intrants coton, directives régionales (UEMOA/CEDEAO) sur les subventions d’engrais, initiatives appuyées par les bailleurs (World Bank, IFAD, GIZ, IFDC) pour améliorer la transparence, la qualité et le ciblage (ex. portefeuille électronique AgriPME). Dans les faits, deux vulnérabilités persistent. D’abord, la livraison tardive ou incomplète des intrants, particulièrement critique dans une culture aussi calée au calendrier que le coton ; une défaillance logistique en amont pénalise tout le cycle. Ensuite, une opacité récurrente dans certaines entreprises publiques clés (à commencer par la SNPT dans le phosphate), régulièrement pointée par les mécanismes de transparence, qui nourrit la suspicion sur l’alignement entre choix industriels et intérêt national.
Avec un rendement moyen autour de 0,8 t/ha et un prix plancher fixé à 300 F CFA/kg, le revenu brut par hectare reste sous pression lorsque les intrants augmentent, même subventionnés. Les engrais NPKSB et urée sont maintenus à 14 000 F CFA le sac, mais leur disponibilité, la qualité et le dosage effectif conditionnent l’impact réel sur les rendements. Le président de la Fédération des producteurs de coton, Koussouwè Kourouféi, résume une angoisse plus large : « La population paysanne vieillit, les jeunes se détournent. Toute la filière coton est en risque. » Le nombre de producteurs a chuté — d’environ 111 000 lors de la campagne 2020-2021 à 76 000 en 2024-2025 —, un signal d’alarme social autant qu’économique.
Les partenaires techniques et financiers financent subventions, logistique et renforcement de capacités (écoles aux champs, digitalisation, bonnes pratiques), et poussent à une harmonisation des politiques d’engrais en Afrique de l’Ouest (Déclaration de Lomé, 2023). Cette assistance a permis d’amortir le choc des prix mondiaux d’intrants. Mais elle ne répond pas entièrement à la question de fond : comment éviter que la dépendance aux importations, l’externalisation de segments stratégiques (approvisionnement, transformation) et la concentration des leviers ne réduisent la marge de manœuvre du Togo sur sa propre chaîne de valeur ? Tant que la transformation du phosphate local en engrais reste partielle et que la gouvernance des entreprises publiques et des PPP demeure opaque, la souveraineté agricole restera fragile.
Le recul de la production, malgré des prix incitatifs affichés, traduit un faisceau de causes : variabilité climatique, abandon de la culture par une partie des producteurs, arbitrages économiques défavorables quand les intrants arrivent tard ou coûtent trop, et gouvernance perfectible qui complique la responsabilisation des acteurs. Les réformes engagées (industrialisation via PIA, renforcement des capacités, subventions ciblées) peuvent produire des effets si trois conditions sont réunies : (1) transparence des contrats et des actionnariats aux interfaces NSCT-PIA-fournisseurs d’intrants ; (2) traçabilité et contrôle qualité des engrais distribués, avec des livraisons à date ; (3) mécanisme de fixation des prix adossé à des données vérifiables (coûts, rendements, cours internationaux) et à une représentation effective des producteurs.
En définitive, l’« écosystème » coton-engrais togolais n’est pas condamné ; il est à un carrefour. La stratégie de transformation locale et l’investissement industriel peuvent créer de la valeur s’ils s’accompagnent d’un alignement d’intérêts vérifiable et d’une concurrence réelle dans les marchés d’intrants. À défaut, la filière continuera d’additionner subventions budgétaires, revenus paysans sous-optimaux et dépendance stratégique, au détriment de la souveraineté agricole que le pays ambitionne.