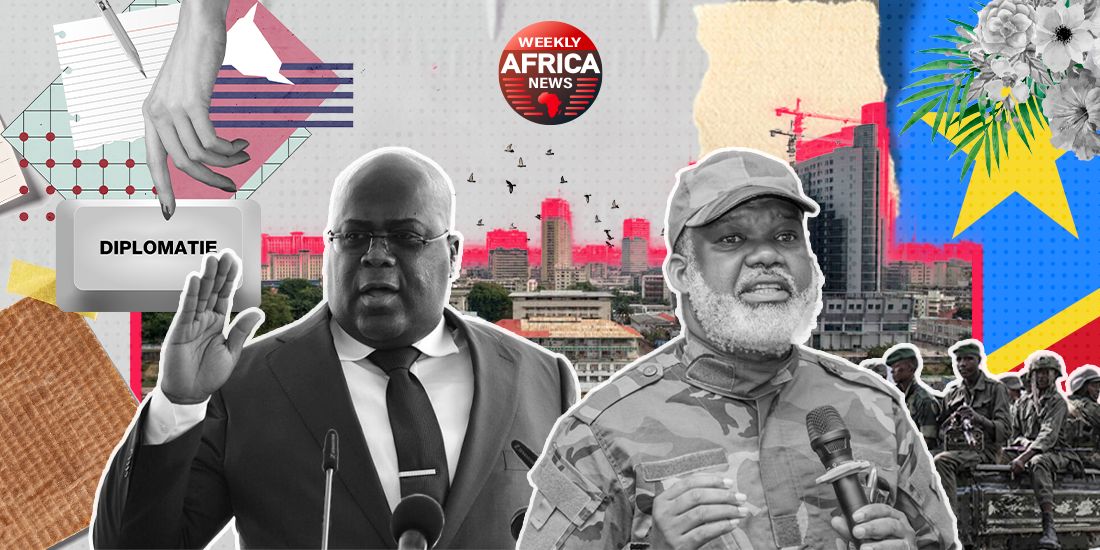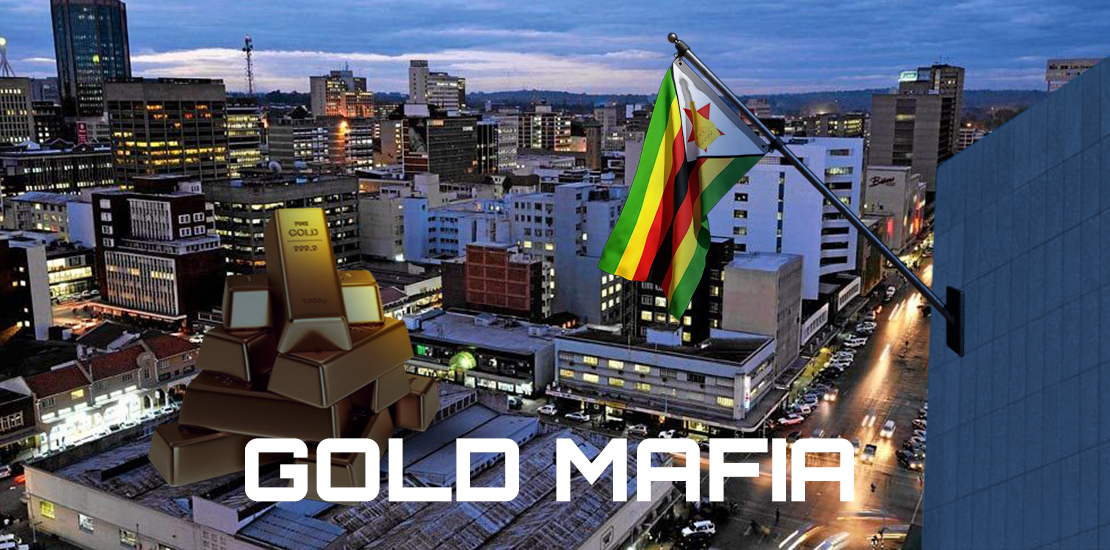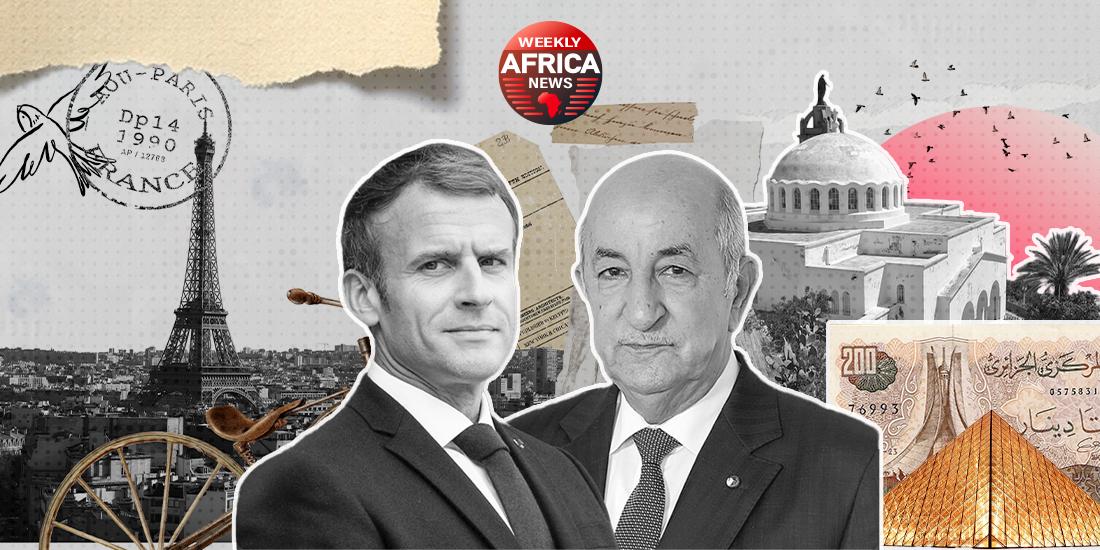Agrobusiness au Sénégal : Pourquoi les promesses de Faye et Sonko peinent à convaincre ?
À l’est de la République démocratique du Congo (RDC), l’économie politique des minerais stratégiques s’écrit dans les interstices du pouvoir provincial. À l’ombre des gouvernorats, une mosaïque d’acteurs (entreprises locales, services de sécurité, maisons d’achat et autorités administratives) lubrifie des circuits parallèles où l’or et le coltan échappent au fisc, financent la guerre et nourrissent des clientèles politiques. Au cœur de ces arrangements, des gouverneurs jouent un rôle d’arbitres, de facilitateurs ou de bénéficiaires indirects, selon les cas, en instituant des prélèvements opaques ou en tolérant des chaînes de contrebande qui s’étirent jusqu’aux marchés asiatiques.
Une partie décisive de l’or et du coltan extraits en Ituri, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu est drainée hors des circuits légaux. Les flux suivent des routes bien balisées vers le Rwanda et l’Ouganda avant d’alimenter les raffineries régionales et, pour le coltan, des fonderies et transformateurs d’Asie, principalement en Chine. Les pertes fiscales pour l’État congolais sont considérables, tandis que des acteurs politico-militaires locaux captent des rentes. Cette architecture n’est pas nouvelle ; elle s’est toutefois densifiée avec la militarisation de l’administration provinciale et la montée en puissance de groupes armés contrôlant des gisements clés.
La prise de contrôle de Rubaya au printemps 2024 par le M23 a basculé un nœud logistique mondial : une part substantielle du coltan mondial provient de ce district. Depuis, une « administration minière parallèle » y organise taxation, contrôle des négociants et escortes des cargaisons. Des témoignages recoupés d’industriels et de diplomates évoquent, à partir de mai 2024, des sorties mensuelles de dizaines de tonnes vers le Rwanda, où le minerai est agrégé à des flux locaux puis exporté. Cette contamination de la chaîne d’approvisionnement bénéficie à des intermédiaires proches des autorités de transit et met en échec les dispositifs de traçabilité. Pour les élites provinciales, l’intérêt est double : conserver des marges de manœuvre financières via des « taxes » non budgétées et maintenir des loyautés locales, y compris au sein des services de sécurité.
En Ituri, les experts des Nations unies ont établi que l’extraction aurifère échappe massivement à l’administration, générant des revenus annuels significatifs pour des groupes armés et des réseaux criminels. Des éléments des forces régulières ont, par endroits, été impliqués dans l’« encadrement » de sites ou la protection d’intérêts privés, détournant des ressources qui devraient financer la sécurité publique. L’or suit ensuite les routes bien connues : comptoirs informels, passes-frontières vers l’Ouganda ou le Rwanda, puis fusion dans des raffineries régionales. Une fois fondu, l’alliage se confond avec d’autres origines ; il peut transiter par le Golfe et rejoindre les grandes places de négoce qui redistribuent vers l’Inde et la Chine. Les sanctions internationales ont commencé à viser certains maillons de ce système mais la plasticité des réseaux demeure.
Le territoire de Shabunda illustre la persistance de schémas découverts il y a presque une décennie : alliances opportunistes entre opérateurs semi-industriels, notabilités locales et groupes armés pour sécuriser l’accès à l’or. Les autorités provinciales ont, à intervalles, annoncé des suspensions d’activités, des déploiements de « police des mines » et des appels à la conformité fiscale. Mais sur le terrain, la multiplication de redevances locales, d’autorisations discrétionnaires et d’unités mixtes de contrôle entretient un écosystème où la frontière entre régulation et rente reste poreuse. Dans ce contexte, des entreprises de façade (coopératives enregistrées, comptoirs « agréés ») servent souvent de véhicules à des intérêts politiques provinciaux, tandis que des fractions d’unités publiques « s’auto-financent » par des barrières routières et des escortes payantes.
Les rapports publics concordent : la valeur d’or artisanal qui sort de l’Est congolais sans être déclarée se chiffre en centaines de millions de dollars par an. Les données d’exportations laissent deviner des écarts structurels : faibles volumes officiels congolais d’un côté ; bonds spectaculaires des exportations aurifères dans les pays de transit de l’autre. Côté coltan, l’arrivée soudaine de volumes en provenance de zones sous contrôle rebelle s’est traduite par une hausse des sorties de concentrés vers des transformateurs asiatiques. Le goulot d’étranglement n’est pas technique, la métallurgie du tantale etant standardisée, mais documentaire : le mélange de flux « certifiés » et non certifiés brouille la piste, et les systèmes de diligence raisonnable sont mis en défaut lorsque les autorités locales de transit sont elles-mêmes parties prenantes.
Comment les profits se cachent-ils ? D’abord par la prolifération de prélèvements parafiscaux au niveau provincial (taxes routières, « frais de contrôle », timbres et permis ad hoc) dont une partie n’est ni tracée ni reversée. Ensuite par l’octroi de titres à des entités locales liées à des entourages de gouverneurs ou à des officiers, qui sous-traitent ensuite à des négociants informels. Enfin par l’implication d’éléments de forces publiques qui assurent, contre rétribution, la fluidité des transports et la sécurité des sites. La pièce maîtresse reste la maison d’achat : juridiquement visible, socialement insérée, financièrement souple, elle avale la production artisanale, l’agrège, la blanchit administrativement, puis la réexpédie vers les hubs régionaux.
L’enjeu dépasse la RDC. Le tantale est stratégique pour l’électronique de puissance et la défense ; l’or reste un actif financier mondial. La demande asiatique, notamment chinoise pour le tantale, donne une profondeur de marché à ces flux. Les pays de transit captent des marges de raffinage et de commission, tandis que des multinationales en aval s’abritent derrière des schémas de conformité qui peinent à percer l’opacité créée à la source. Les initiatives occidentales de « chaînes responsables », si elles ont réduit certains risques dans l’étain et le tungstène, butent sur la combinaison unique de la valeur de l’or, de la conflictualité persistante et de la capture institutionnelle locale.
L’État congolais perd des recettes qui pourraient financer écoles, routes et hôpitaux. Les communautés minières restent enfermées dans l’arbitraire : taxes illégales, travail précaire, dangers sanitaires. La compétition entre réseaux armés et segments de l’appareil d’État pour capter la rente entretient une violence circulaire ; elle fragilise aussi les gouverneurs qui tentent des réformes, exposés à des coalitions d’intérêts contrariés.
En définitive, les annonces sporadiques de suspension, les patrouilles de police minière et les communiqués des maisons d’achat ne suffisent plus. Ce qu’appelle la situation, c’est un contrôle externe et continu : (1) une traçabilité indépendante à la source, auditée par des tiers sans liens avec les autorités provinciales ni les opérateurs locaux ; (2) la publication, en temps quasi réel, des volumes agrégés par comptoir, par province et par poste frontalier ; (3) l’obligation de transparence sur les bénéficiaires effectifs de toutes les entités détentrices de titres ou d’agréments ; (4) l’arrimage rigoureux des hubs régionaux et des transformateurs asiatiques à ces exigences, avec sanctions automatiques en cas de non-conformité ; (5) un mandat renforcé d’enquête financière, adossé à la justice congolaise mais piloté par des experts internationaux indépendants. Sans ces garde-fous, l’or et le coltan continueront de financer un ordre local où la fonction publique sert de paravent à des rentes privées et où les gouvernorats, loin d’assainir la filière, en deviennent des pivots.