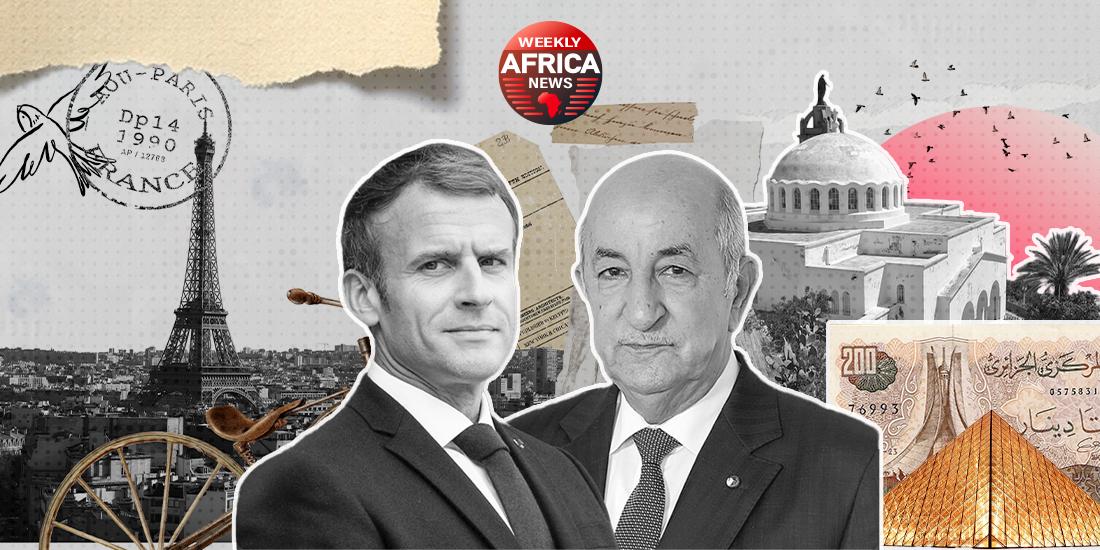Agrobusiness au Sénégal : Pourquoi les promesses de Faye et Sonko peinent à convaincre ?
Au Maroc, l’irruption du collectif GenZ212 a pris de court partis, syndicats et institutions. Né en ligne et massivement relayé sur Discord, TikTok et Instagram, ce mouvement de jeunes, souvent mineurs ou à peine sortis de l’université, a porté dans la rue des revendications sociales simples : des hôpitaux qui fonctionnent, une école publique digne, la fin des rentes et de l’impunité. Au cœur de la controverse, une question structurante : qui finance vraiment GenZ212, et que révèle l’architecture (ou l’absence d’architecture) financière de ce soulèvement ?
Les faits établis convergent : GenZ212 est une mobilisation sans structure déclarée, à leadership diffus, organisée par canaux thématiques (santé, éducation, juridique) sur des serveurs publics. Cette organisation “plate” a deux conséquences financières. D’abord, la logistique est minimaliste : pas de locaux, peu de matériel, une communication virale qui ne coûte presque rien. Ensuite, l’essentiel des dépenses relève de micro-frais (transports, banderoles, assistance juridique) aisément couverts par l’auto-financement et de petites cagnottes. Plusieurs messages publics du collectif insistent d’ailleurs sur une discipline budgétaire et sur la “non-affiliation” à des partis ou à des bailleurs extérieurs. Des cagnottes de soutien juridique ont émergé, avec des montants modestes, suggérant un financement diffus et opportuniste plutôt qu’un “trésor de guerre”.
Trois hypothèses circulent. La première, la plus solide empiriquement, est celle d’un financement endogène : contributions personnelles, coups de main logistiques, dons ponctuels en ligne. Le profil sociologique de la base (étudiants, jeunes actifs précaires) ne plaide pas pour des flux massifs ; mais l’effet réseau compense en partie par la volumétrie des micro-dons et la gratuité des outils numériques.
La deuxième renvoie aux ONG et à la société civile. Le Maroc compte un tissu associatif habitué à lever des fonds (souvent étrangers) pour des causes juridiques ou sociales. À ce stade, rien n’établit un financement direct et structuré de GenZ212 par une ONG donnée. En revanche, des relais existent : observateurs, hotlines d’assistance, mise à disposition d’avocats, documentation juridique. C’est moins une “prise en charge” financière du mouvement qu’une convergence de routines militantes autour de justiciables jeunes et exposés.
La troisième, plus polémique, touche à l’ingérence étrangère. Rumeurs et vidéos virales évoquent des “infiltrations” de serveurs publics ou des tentatives de récupération. Les plateformes ouvertes rendent plausible la présence d’acteurs exogènes (militants d’autres pays, comptes coordonnés, curieux) sans que cela équivaille à un financement ou à une direction opérationnelle. À ce jour, aucune preuve indépendante et robuste n’atteste de flux financiers étrangers pilotant GenZ212. La prudence s’impose pour distinguer exposition informationnelle (inévitable sur réseaux ouverts) et dépendance financière (non démontrée).
Dans l’opposition institutionnelle comme chez les mouvances non reconnues, les prises de position publiques se sont multipliées : condamnation des violences, appels au dialogue, demandes de libération des détenus. Ce soutien rhétorique ne prouve pas un financement. En revanche, il traduit une stratégie de “co-positionnement” : se montrer à l’écoute d’une base juvénile que les partis ont du mal à organiser. À la marge, des entrepreneurs politiques tentent de transformer l’énergie de GenZ212 en offre partisane. Là encore, l’enjeu est moins financier qu’organisationnel : capter un capital d’attention construit gratuitement en ligne.
Le mouvement prospère sur un terrain social connu : chômage des jeunes élevé, inégalités territoriales d’accès aux soins, sentiment d’injustice face à des investissements jugés “vitrines” (Coupe du monde 2030, grands chantiers) pendant que des maternités ou des urgences peinent à répondre. La survenue de drames hospitaliers hautement symboliques a catalysé la colère. L’exécutif a répondu en affirmant “entendre” les revendications et en appelant au calme, tout en contestant l’idée d’un arbitrage budgétaire systématique aux dépens des secteurs sociaux. Autrement dit, le débat porte autant sur l’allocation et l’efficacité des dépenses publiques que sur leurs montants absolus.
Le cœur du dossier n’est pas un mystérieux caissier tapi dans l’ombre, mais la combinaison de trois dynamiques : 1) des coûts d’organisation quasi nuls grâce aux plateformes, 2) un répertoire d’action fondé sur des rassemblements éclairs et des visuels amateurs, 3) un récit simple et fédérateur (“des hôpitaux, pas des stades”) qui abaisse le besoin de marketing payant. Dans ce cadre, un financement lourd serait presque un contresens stratégique : il créerait de la traçabilité et de la suspicion, tout en offrant aux autorités un angle d’attaque. La sobriété financière est ici une assurance-vie politique.
Pour les institutions, l’enjeu n’est pas tant d’identifier un bailleur occulte que de reconstruire de la confiance : transparence des priorités budgétaires, preuves tangibles d’amélioration des services, canaux de concertation ouverts aux moins de 25 ans, réponse judiciaire proportionnée. À court terme, une désescalade crédible suppose des signaux politiques (évaluations publiques de projets, audits, calendrier d’actions mesurables). À moyen terme, la réduction des vulnérabilités qui nourrissent la mobilisation (santé de base, écoles, emploi local) déterminera la durée de vie de GenZ212.
À ce stade, tout indique un mouvement auto-organisé, à coûts maîtrisés, alimenté par des micro-financements et des ressources militantes périphériques, plus que par une manne extérieure. La portée de GenZ212 ne se jouera pas dans une comptabilité de dons, mais dans sa capacité à transformer l’indignation en améliorations vérifiables et dans la capacité de l’État à y répondre sans réduire la question à la piste, commode mais réductrice, d’un financement caché.