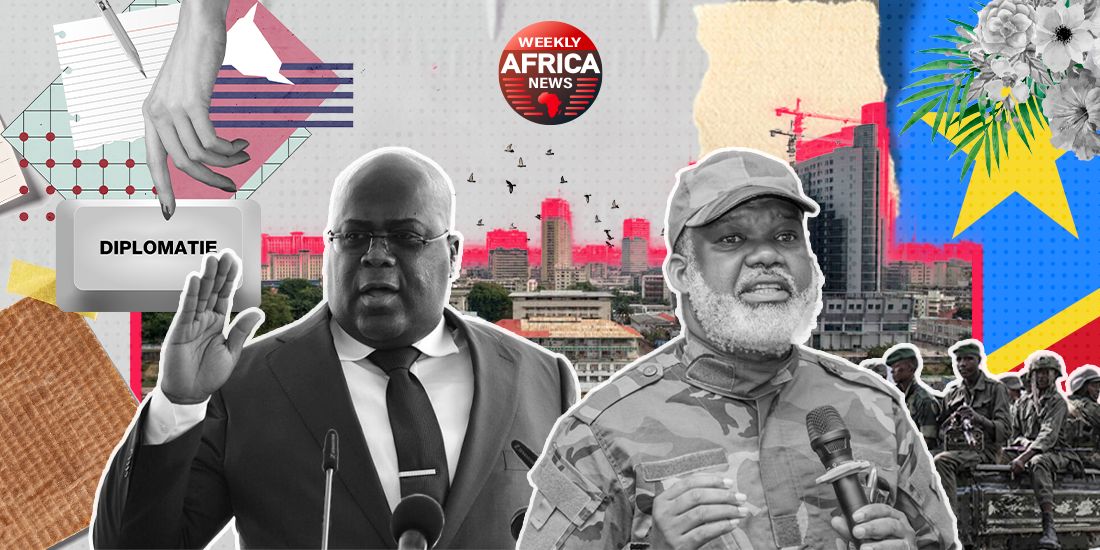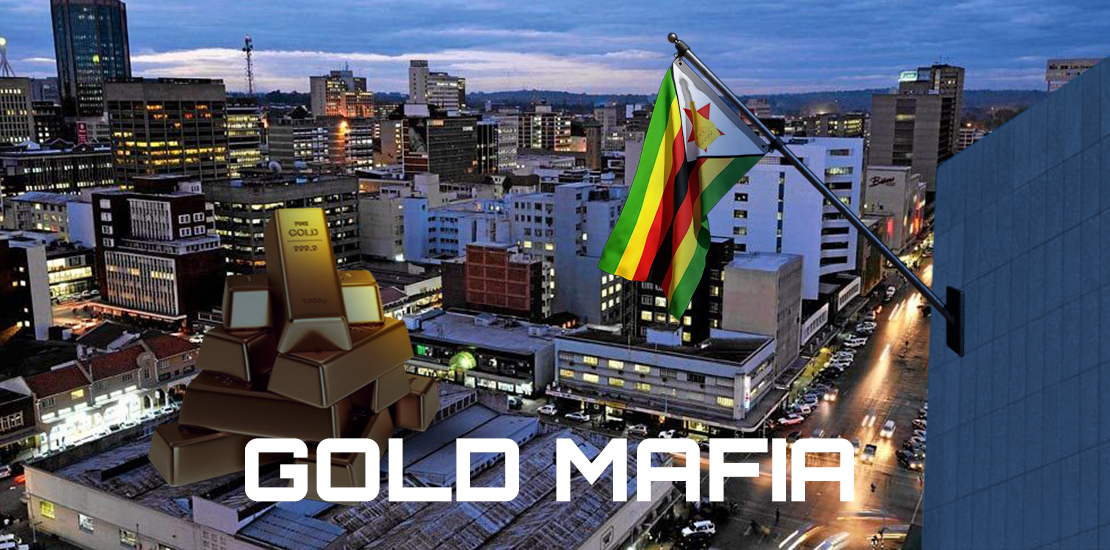Agrobusiness au Sénégal : Pourquoi les promesses de Faye et Sonko peinent à convaincre ?
De Malabo à Abuja, un constat s’impose : dans l’ombre des capitales africaines, des multinationales occidentales du pétrole et du gaz influencent durablement la conception des lois, des stratégies et des investissements. L’enjeu dépasse la rhétorique. Il touche à la souveraineté des États, à l’allocation des ressources publiques et au rythme de la transition énergétique sur un continent où près de 600 millions de personnes vivent encore sans électricité. Cette enquête expose les mécanismes d’influence, les acteurs et les conséquences, sans parti pris.
Le cœur du sujet est la capacité d’acteurs privés à peser sur l’appareil normatif. Au Nigeria, des câbles diplomatiques rendus publics en 2010 ont révélé qu’une major anglo-néerlandaise se vantait d’avoir des relais dans plusieurs ministères clés, lui offrant un accès privilégié aux décisions. Dans d’autres pays, des réformes de codes pétroliers et gaziers ont été calibrées pour sécuriser les investissements fossiles : clauses de stabilité, exemptions fiscales élargies, standards environnementaux assouplis ou délais d’évaluation accélérés. Rien d’illégal en soi, mais une asymétrie d’expertise et de moyens qui oriente la règle au bénéfice d’intérêts industriels.
L’influence s’exerce aussi sur la scène internationale. À la COP27, plus de six cents représentants liés aux combustibles fossiles ont obtenu des accréditations ; vingt-neuf pays comptaient même des lobbyistes au sein de leurs équipes officielles. L’effet est un cadrage du débat : insister sur le gaz comme « énergie de transition », mettre en avant la sécurité d’approvisionnement et le coût immédiat, relativiser l’urgence de normes contraignantes. La présence de ces acteurs, souvent mieux dotés que les délégations de pays vulnérables, pèse sur le tempo des engagements.
Les données mettent en lumière un décalage entre potentiel renouvelable et flux financiers. L’Afrique concentre environ 60 % des meilleurs gisements solaires mondiaux, mais ne représente qu’une faible part de la capacité photovoltaïque installée. Dans le même temps, les grands projets continuent de privilégier le pétrole et surtout le gaz : terminaux de GNL, centrales alimentées par de nouveaux champs offshore, pipelines transfrontaliers. Ce biais tient à des cadres d’incitation attractifs et à la liquidité des marchés fossiles, mais aussi à une ingénierie contractuelle maîtrisée par les majors et leurs conseils, qui capte l’attention des décideurs.
Les majors occidentales poursuivent des objectifs prévisibles : protéger des actifs existants, ouvrir de nouvelles réserves, garantir des régimes fiscaux stables et des normes compatibles avec leurs calendriers d’investissement. Elles financent des études vantant le rôle du gaz dans la transition, soutiennent des plateformes sectorielles qui plaident pour un « droit au développement » par les hydrocarbures, et déploient un lobbying feutré via cabinets d’avocats, consultants, associations professionnelles et think tanks. Leur stratégie consiste moins à s’opposer frontalement aux renouvelables qu’à en retarder l’essor là où cela menace la valorisation d’actifs fossiles.
Les gouvernements, eux, arbitrent sous fortes contraintes budgétaires et sociales. Dans des pays producteurs, les revenus d’hydrocarbures restent déterminants pour l’équilibre des finances publiques. La promesse d’emplois, de recettes et d’infrastructures pèse face aux urgences sociales. De nombreux dirigeants avancent un argument de justice : électrifier à grande échelle justifierait l’usage des ressources gazières disponibles. Cette position, portée par des organisations professionnelles africaines, cherche à concilier développement et transition, mais elle conforte de facto la priorité donnée aux projets fossiles.
La société civile joue un rôle de contre-pouvoir, documentant impacts locaux et risques juridiques. Dans le delta du Niger, des décennies d’exploitation ont laissé des passifs environnementaux massifs et un contentieux foisonnant ; la mémoire des « Ogoni Nine », exécutés en 1995 après avoir dénoncé la pollution, alimente encore la défiance. Des affaires comme OPL245, autour d’une licence octroyée en 2011 et d’un paiement d’environ 1,1 milliard de dollars, illustrent le brouillage entre lobbying d’influence et capture des décisions publiques, même lorsque les procédures se soldent par des issues judiciaires contrastées.
Les choix actuels engagent des trajectoires difficiles à infléchir. Des infrastructures fossiles mobilisent des capitaux lourds et des contrats de long terme. Si la demande mondiale de gaz s’infléchit au rythme des politiques climatiques, une partie des actifs africains pourrait être dépréciée avant d’avoir livré les recettes attendues : c’est le risque d’« actifs échoués », avec à la clé endettement, arbitrages budgétaires défavorables et faibles marges pour financer santé, éducation ou adaptation climatique. Sur le terrain, l’expansion fossile mal régulée peut aussi exacerber les conflits d’usage des terres, fragiliser la confiance dans les institutions et retarder la mise à niveau des réseaux indispensables au déploiement des renouvelables.
À l’inverse, une accélération ordonnée du solaire et de l’éolien, combinée à des mini-réseaux et à des solutions de stockage, réduit la facture d’importations, atténue la vulnérabilité aux chocs de prix et crée des emplois locaux d’installation et de maintenance. Mais pour y parvenir, il faut des réformes concrètes : cadres tarifaires prévisibles, appels d’offres transparents, garanties de change pour abaisser le coût du capital, régulateurs renforcés et planification des réseaux pour intégrer des capacités variables.
Trois leviers peuvent limiter la capture des politiques. D’abord, la transparence intégrale des contrats et des bénéficiaires effectifs : publier systématiquement les termes, les clauses de stabilité et les engagements environnementaux rend le débat public plus informé. Ensuite, insérer des clauses de flexibilité et d’ajustement climatique dans les accords d’infrastructures : elles évitent de verrouiller l’allocation future du capital et permettent des révisions si les marchés ou les technologies évoluent. Enfin, construire une diplomatie énergétique africaine plus offensive : négocier des « paquets transition » combinant investissements renouvelables, interconnexions, formation et financement concessionnel, afin de desserrer la contrainte du coût du capital qui pénalise les projets propres.
Ce tableau n’appelle ni anathème ni naïveté. Les compagnies répondent à des incitations économiques, les gouvernements à des urgences sociales réelles. Mais la profondeur des faits réunis suggère un système d’influence efficace pour protéger des intérêts fossiles, au détriment d’options plus soutenables. L’enjeu est d’abord institutionnel : corriger des asymétries d’information, de financement et de pouvoir de négociation. L’Afrique a le potentiel de conduire une transition juste et souveraine ; la condition est que ses politiques énergétiques soient écrites à ciel ouvert, sur la base d’évaluations indépendantes et d’objectifs publics explicites.