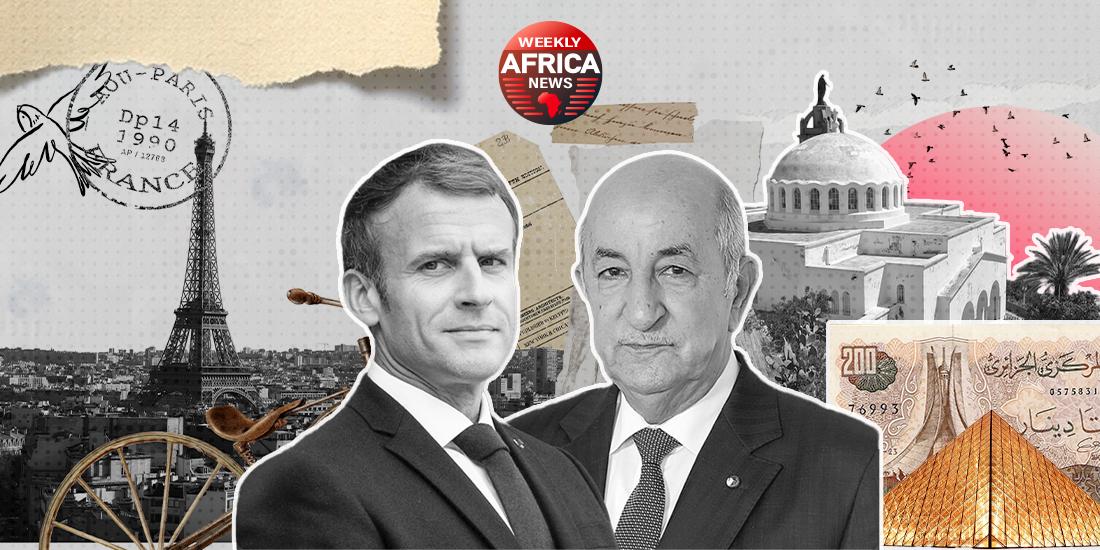Agrobusiness au Sénégal : Pourquoi les promesses de Faye et Sonko peinent à convaincre ?
Problème au cœur de l’enquête
L’ancienne présidente de l’Assemblée nationale sud-africaine et ex-ministre de la Défense, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, est poursuivie pour des faits présumés de corruption et de blanchiment d’argent liés à des marchés de logistique militaire. L’affaire, désormais devant la High Court de Pretoria, cristallise les critiques sur la probité des élites et révèle, au-delà d’un dossier individuel, des failles persistantes de la commande publique dans le secteur de la défense.
Les faits établis
Après une perquisition à son domicile en mars 2024, Mapisa-Nqakula a perdu, début avril, un recours d’urgence visant à empêcher son arrestation. Elle a démissionné le lendemain de la présidence de l’Assemblée, puis s’est rendue à la police à Pretoria, où elle a été formellement inculpée. La justice lui a accordé une libération sous caution de 50 000 rands avec remise de passeport. Le parquet la poursuit sur 13 chefs au total, 12 de corruption et un de blanchiment, pour des « paiements indus » et des flux d’argent liquide reçus entre 2016 et 2019, lorsqu’elle dirigeait le ministère de la Défense. Elle nie toute malversation et parle d’un dossier « politique ». Dans sa lettre de départ, elle a précisé : « Ma démission n’est en aucun cas un aveu de culpabilité. »
Le mécanisme présumé
Au cœur du dossier, un faisceau de contrats logistiques pour l’Armée sud-africaine (SANDF) liés aux opérations extérieures, notamment le rapatriement (backloading) d’équipements depuis la République démocratique du Congo. Selon l’acte d’accusation et des affidavits versés au dossier, Mapisa-Nqakula aurait sollicité jusqu’à 4,5 millions de rands de la part d’une cheffe d’entreprise du secteur, et reçu en liquide environ 2,1 à 2,3 millions de rands en au moins onze versements. Une demande supplémentaire de 105 000 dollars n’aurait jamais été honorée. Ces versements, toujours selon les témoins et pièces du dossier, auraient accompagné l’attribution d’un marché dépassant la barre des 100 millions de rands pour le transport d’équipements stratégiques. Les détails qui filtrent donnent à voir la banalité procédurale d’une corruption par « petits arrangements », où les espèces et gratifications sont dissimulées derrière des services logistiques hautement techniques.
Cadre et dysfonctionnements
Le secteur de la défense en Afrique du Sud cumule plusieurs fragilités : complexité des besoins (transport d’équipements sensibles, théâtres extérieurs), forte asymétrie d’information entre acheteurs publics et prestataires, marges logistiques élevées, et procédures parfois dérogatoires au droit commun pour des motifs de sécurité. Cette conjonction accroît les risques d’ententes et de surfacturations. Les rapports de l’Auditeur général ont, année après année, signalé un niveau élevé de dépenses irrégulières au ministère de la Défense, concentrant à lui seul une part substantielle des montants recensés au niveau national. De telles alertes ne prouvent pas, en soi, une infraction pénale ; elles documentent en revanche un environnement de contrôle interne insuffisant, où les garde-fous (traçabilité des flux, séparation stricte des fonctions, supervision juridique des contrats) ne sont pas toujours à la hauteur.
L’architecture institutionnelle mise à l’épreuve
L’affaire Mapisa-Nqakula met aussi en lumière la fragilité de la gouvernance parlementaire. Voir la première chambre dirigée par une personnalité visée par une perquisition a exposé un conflit d’intérêt objectif : gardienne de l’intégrité de l’institution, la Présidente du Parlement était simultanément au centre d’une enquête pénale. La démission rapide a évité une crise ouverte, mais non sans heurts : le bureau de la Présidente avait d’abord « dénié » les accusations, et un recours judiciaire a tenté de freiner l’action des enquêteurs. Plus tard, une demande pour que le ministère de la Défense finance sa défense a suscité un rappel à l’ordre sur le respect des protocoles et l’usage des deniers publics. Du côté des poursuites, la coordination du Parquet a également été scrutée : la bascule d’une dirigeante d’entreprise du secteur comme témoin d’État (au titre de l’article 204) après l’évanouissement provisoire d’un dossier connexe a nourri des interrogations sur la cohérence des stratégies judiciaires. Ce n’est pas anodin : dans les affaires de marché public, la robustesse probatoire se joue souvent sur la qualité des témoins et l’alignement des dossiers.
Acteurs et intérêts
Le ministère public cherche à établir un schéma de « pay-to-play » : des paiements en échange de facilités dans l’attribution ou l’exécution de contrats logistiques. L’intérêt stratégique est double : frapper fort pour dissuader et montrer que l’ère d’impunité touche à sa fin.
La défense soutient une thèse de politisation : poursuites opportunistes à l’approche d’échéances électorales et lecture biaisée de transactions privées. Elle mise sur les incertitudes des témoignages, les contradictions des montants et l’absence de trace bancaire directe de certaines remises en cash.
Les prestataires militaires veulent préserver la légitimité de marchés sensibles, souvent passés dans l’urgence opérationnelle : ils plaident la conformité aux cahiers des charges et la réalité des coûts (convois sécurisés, itinéraires complexes, manutention d’équipements « mission-critiques »).
Les institutions politiques arbitrent entre garantie des droits et exigence d’exemplarité. La majorité a soutenu la démission, tout en évitant de condamner avant jugement ; l’opposition, elle, a mis la pression au nom de la crédibilité institutionnelle.
Mise en perspective politique
L’inculpation intervient à un moment où la défiance citoyenne est élevée. Des enquêtes d’opinion réalisées en 2024 indiquent qu’une large majorité de Sud-Africains pensent que « la plupart » des députés sont impliqués dans la corruption. Dans les urnes, l’ANC a perdu sa majorité pour la première fois depuis 1994, ouvrant une séquence de coalition délicate. Il serait abusif d’attribuer ce revers à une seule affaire ; mais la succession de scandales pèse sur l’image d’un État capable de s’autoréguler. Dans ce contexte, la capacité des autorités à mener un procès rapide, équitable et solidement étayé devient un test de crédibilité, bien au-delà du seul sort judiciaire de l’ancienne Présidente.
L’impact sur les institutions et la confiance
À court terme, l’affaire a déjà produit un effet vertueux : le respect apparent du principe de redevabilité, qui a conduit à la démission d’une figure de premier plan et à un traitement judiciaire sans passe-droit visible. À moyen terme, l’enjeu est systémique. S’il s’avère que des contrats logistiques ont été « capturés » par des réseaux d’influence, il faudra renforcer la prévention : publicité des appels d’offres, transparence des avenants et des « réparations » logistiques, audit ex-post indépendant, interdiction stricte des paiements en cash entre parties liées au marché et sanctions rapides en cas de manquement. La jurisprudence issue de ce procès orientera durablement la conduite des affaires publiques.
Un dossier complexe, une exigence de mesure
La sévérité des chefs d’inculpation retenus ne préjuge pas de la culpabilité. La défense contestera la matérialité des « contreparties », l’imputabilité personnelle de l’ex-ministre et la fiabilité de témoins susceptibles de négocier leur propre exposition pénale. À l’inverse, le ministère public tentera d’assembler une chaîne probatoire (flux financiers, chronologie des décisions, communications, témoignages convergents) suffisamment solide pour dépasser le seuil du doute raisonnable. L’opinion, lassée par les scandales, réclame des verdicts rapides ; mais la célérité ne peut se substituer à la rigueur. La justice devra arbitrer entre des versions concurrentes dans un univers contractuel technique, où les zones grises sont nombreuses.
Conclusion
L’inculpation de Nosiviwe Mapisa-Nqakula est plus qu’une affaire personnelle : elle interroge la capacité de l’État sud-africain à discipliner ses chaînes d’achat dans un secteur critique, et à faire vivre le principe d’exemplarité au sommet. Si la présomption d’innocence s’impose, ce dossier agit déjà comme un révélateur : celui d’une gouvernance parlementaire vulnérable aux conflits d’intérêts, d’une commande publique exposée aux arrangements, et d’un corps social très attentif aux signaux d’intégrité. La meilleure réponse, au-delà du seul verdict, tiendra dans des réformes procédurales concrètes et la constance d’une justice qui, sans excès, sanctionne les manquements et protège les institutions.