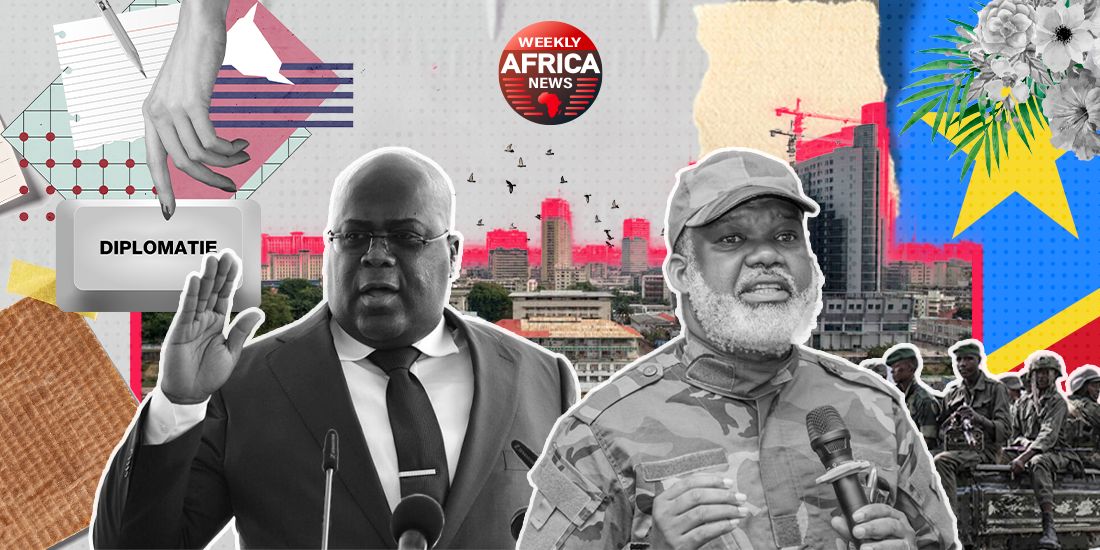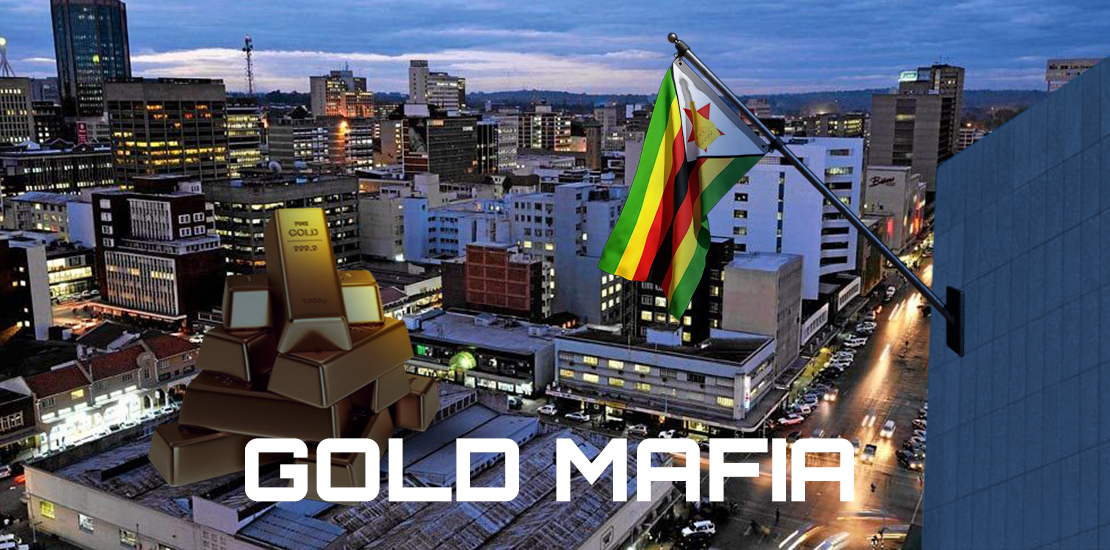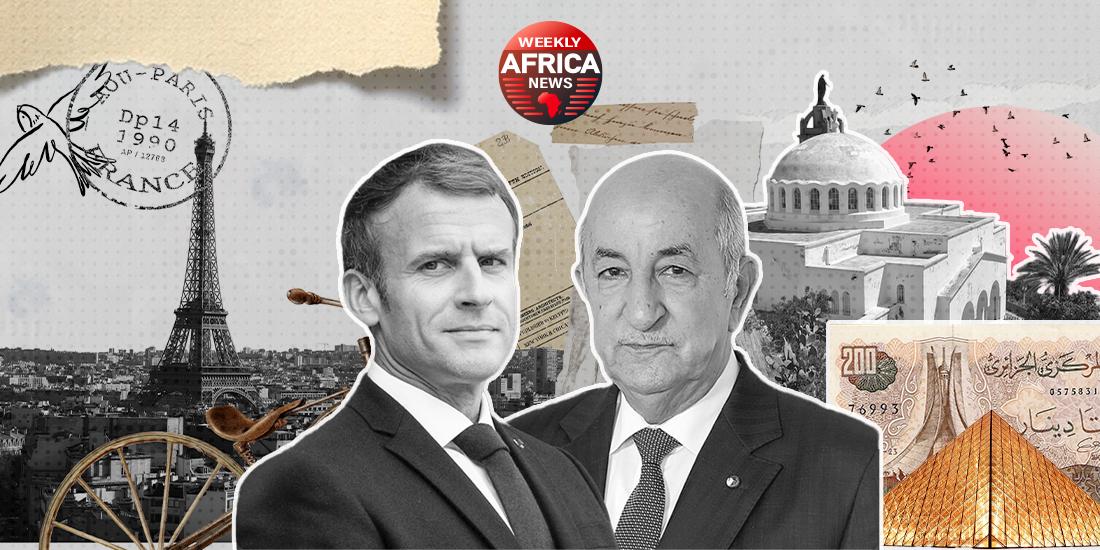Agrobusiness au Sénégal : Pourquoi les promesses de Faye et Sonko peinent à convaincre ?
Au cœur de la saison des pluies 2024, des milliers d’agriculteurs kényans ont découvert que des sacs d’« engrais » achetés dans le cadre du programme public de subvention n’étaient que de la poussière de carrière, du diatomite ou des matières inertes rebaptisées. La confirmation officielle est venue des autorités de normalisation : des lots substandards circulaient bel et bien dans les dépôts de l’agence publique de distribution. « Beware of substandard fertilizer », a même prévenu le régulateur, en citant une marque incriminée et des échantillons non conformes. Cette affaire, baptisée par la presse locale le « fake fertiliser scandal », a déclenché une chaîne d’enquêtes, de poursuites pénales et une tentative d’impeachment contre le ministre de l’Agriculture.
Les faits établis
Au printemps 2024, l’autorité de normalisation a saisi 5 840 sacs jugés non conformes dans les entrepôts de la National Cereals and Produce Board (NCPB), pivot logistique de la subvention. Des produits commercialisés comme « organique » (notamment sous les appellations GPC Original Plus et BL-GPC Original) contenaient principalement du diatomite, loin des spécifications du standard national KS 2290:2018. Parallèlement, la police anticorruption et le parquet ont visé deux plans d’approvisionnement : d’une part, des lots d’« amendement de sol » requalifiés en engrais et, d’autre part, une chaîne d’emballage-étiquetage ayant facilité la fraude.
Les responsabilités administratives et politiques
Trois niveaux apparaissent. D’abord, la NCPB, qui a réceptionné et écoulé des produits non conformes. Trois de ses dirigeants (dont le directeur général) ont été inculpés pour conspiration en vue d’escroquer, abus de fonction et usage de documents falsifiés, dans un dossier chiffré à quelque 209 millions de shillings. Ensuite, le Kenya Bureau of Standards (KEBS), qui a suspendu plusieurs agents et retiré des autorisations après avoir constaté que le produit effectivement vendu différait de celui initialement certifié. Enfin, le ministère de l’Agriculture : son titulaire, sous intense pression politique, a été sauvé par une commission parlementaire spéciale, sans pour autant effacer la question clé : qui, précisément, a manqué dans la chaîne d’assurance-qualité ?
Les entreprises en cause et leurs lignes de défense
Deux sociétés liées à l’homme d’affaires Josiah Kariuki (SBL Innovate Manufacturers Ltd et Fifty-One Capital (K) Ltd) sont au centre du volet « engrais organiques ». Le parquet les accuse d’avoir apposé indûment la marque de conformité et vendu comme engrais des matières inertes. La défense rétorque que les informations du régulateur sont « fausses et diffamatoires », SBL ayant même attaqué l’agence de normalisation en justice. Autre front : KEL Chemicals, dont l’usine a été temporairement fermée par les autorités, la direction reconnaissant un « défaut de production » limité à quelques milliers de sacs sur une courte période. Dans chaque cas, l’enjeu probatoire est le même : démontrer, analyses en laboratoire à l’appui, la composition réelle et la traçabilité de chaque lot mis en circulation.
La mécanique de la fraude
L’enquête et un documentaire d’investigation ayant fait grand bruit ont mis au jour une chaîne simple mais efficace : extraction de matériaux bon marché (terre, diatomite), ensachage dans des sacs imprimés, puis injection dans le circuit public via des dépôts NCPB, où l’e-voucher des agriculteurs se transforme en retrait de sacs subventionnés. La contrefaçon de l’emballage, l’abus de la « standardisation mark » et la porosité des contrôles à réception ont été déterminants. Un témoignage parlementaire résume la gravité : « les droits socio-économiques des agriculteurs ont été bafoués », a insisté un député membre de la commission spéciale.
Des agriculteurs pénalisés au pire moment
La saison des longues pluies détermine l’assise des récoltes de maïs et d’autres vivriers. Recevoir de la poussière de carrière « quarry dirt » à la place d’un intrant nutritif signifie : retards d’implantation, pertes de rendement, coûts de re-semis et de rattrapage (top-dressing) et, surtout, une perte de confiance envers la filière publique. Face au tollé, le président a ordonné l’indemnisation des victimes : « les agriculteurs… doivent être compensés », a-t-il martelé. Dans les faits, l’exécutif a proposé des sacs de complément (top-dressing) et, pour les lots non utilisés, un échange contre du fertilisant conforme. Mais le décalage entre promesse politique et exécution bureaucratique a nourri la colère, des associations d’agriculteurs dénonçant des procédures opaques et des indemnisations tardives.
Un choc économique et alimentaire
L’agriculture pèse plus d’un cinquième du PIB kényan et a porté le rebond de croissance en 2023 après plusieurs années de sécheresse. En compromettant la productivité au champ, l’incident ajoute une vulnérabilité dans un pays encore dépendant des importations de céréales et où les prix du maïs restent nerveux. Le scandale a aussi un coût budgétaire : l’État, qui vend le sac subventionné à 2 500 KSh, doit financer des rappels et des compensations, tout en renforçant les contrôles. L’effet social est tangible : petits exploitants fragiles, trésoreries attaquées, endettement de campagne et défiance envers les institutions censées protéger le consommateur agricole.
Cadre élargi : réformes inachevées
L’e-voucher a digitalisé l’accès à la subvention, mais la chaîne physique — appels d’offres, importations locales, formulations, certificats, logistique, contrôles à la réception — reste l’angle mort. Trois failles ressortent : 1) la traçabilité insuffisante lot-par-lot (numéro unique, laboratoire assigné, registre public), 2) l’ineffectivité des audits inopinés en entrepôts publics et chez les mélangeurs, 3) l’absence de séparation stricte des tâches entre certification, inspection et distribution. Tant que l’organisme de normalisation et le distributeur publics n’auront pas des interfaces auditées par un tiers indépendant, la tentation restera forte de « jouer » avec la marque de conformité.
Le politique dans l’équation
L’onde de choc a atteint le sommet de l’État : une motion d’impeachment a été lancée contre le ministre de l’Agriculture. Si une commission spéciale a finalement jugé les accusations non suffisamment étayées pour le démettre, des controverses sur des « pressions » et sur la composition de la commission ont terni l’image du processus. Sans trancher sur ces allégations, le message pour la politique publique est clair : l’architecture de gouvernance des intrants agricoles doit être à l’abri des intérêts liés, avec des obligations de publication des tests, des marchés et des flux.
Ce que révèle l’affaire
D’abord, un système de contrôle centré sur le papier (permis, certificats) plutôt que sur la preuve scientifique indépendante et la vérification physique au dernier kilomètre. Ensuite, la puissance de l’emballage : avec un sac imprimé et un tampon de conformité, un « conditionneur » devient, aux yeux du guichet, un « engrais ». Enfin, l’insuffisante préparation à la fraude de masse : en 2025 encore, les autorités anticontrefaçon saisissaient des centaines de milliers de sacs d’emballage vides destinés à la tromperie, signe que la logistique de la contrefaçon s’adapte plus vite que les contrôles.
Quelles garanties pour la prochaine saison ?
Les solutions sont connues : sérialisation infalsifiable de chaque sac et registre public des lots ; obligation d’un test de conformité indépendant avant et après livraison NCPB, avec publication des résultats ; audits croisés KEBS-Laboratoires-NCPB, sous supervision du Vérificateur général ; sanctions dissuasives pour l’abus de la marque de normalisation ; et mécanisme d’indemnisation automatique (sans friction) via l’e-voucher quand une non-conformité est prouvée. À plus long terme, la politique d’intrants doit articuler subventions, santé des sols et diversification (analyses régulières, chaulage, rotations), faute de quoi chaque « saison perdue » pèsera sur la sécurité alimentaire.
Conclusion
Le scandale des faux engrais n’est pas qu’une fraude : c’est un stress-test grandeur nature d’un dispositif public appelé à livrer des millions de sacs chaque année. Il a révélé des failles de traçabilité, d’intégrité et de gouvernance qui, si elles ne sont pas corrigées, mineront la productivité agricole et la confiance citoyenne. L’heure n’est ni aux boucs émissaires, ni aux promesses vagues, mais à l’ingénierie institutionnelle : transparence des lots, indépendance des contrôles et responsabilité à chaque maillon de la chaine pour que l’« engrais subventionné » redevienne ce qu’il doit être : un facteur de rendement, pas un risque systémique.