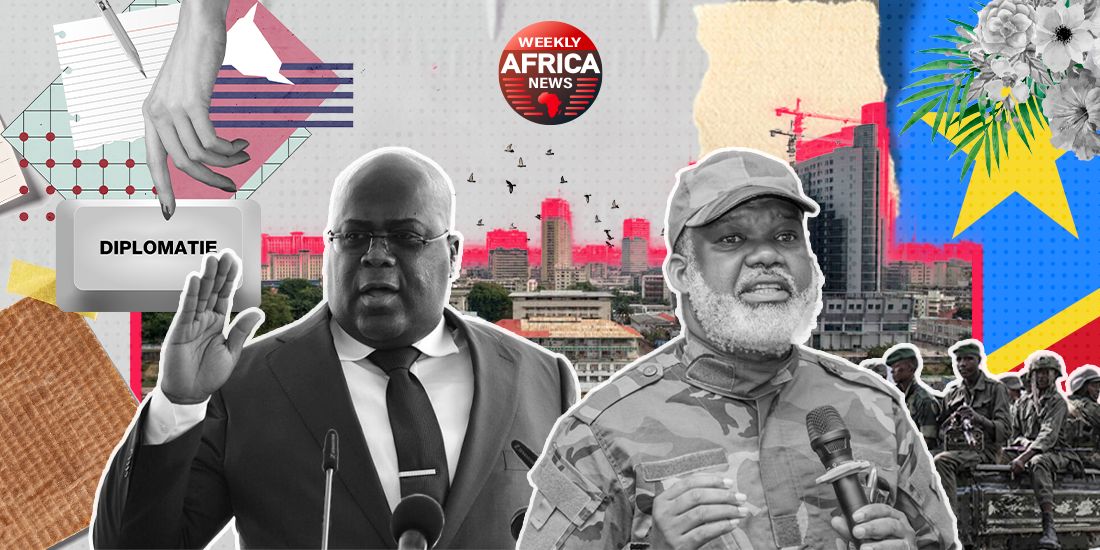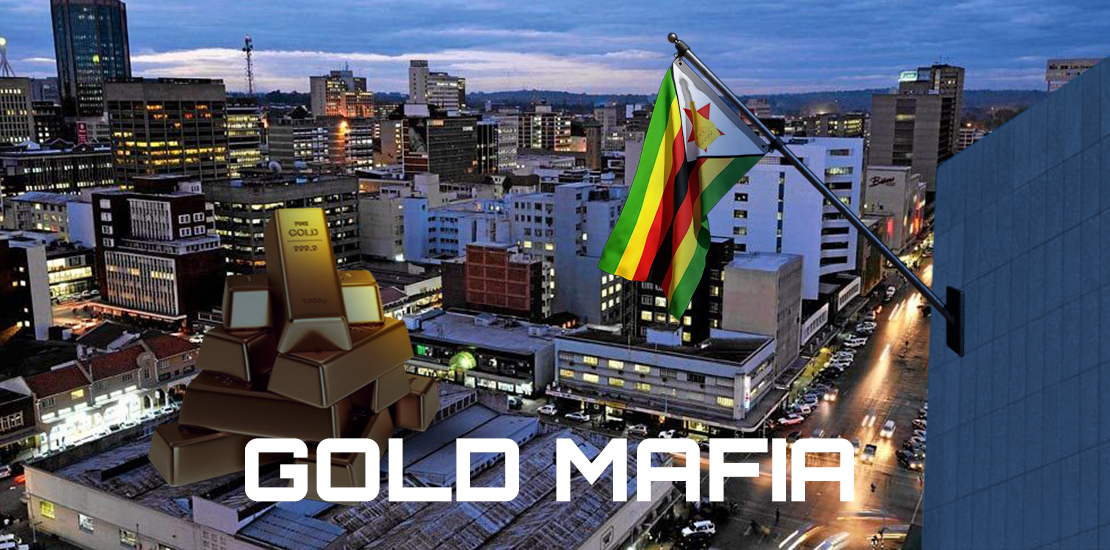Agrobusiness au Sénégal : Pourquoi les promesses de Faye et Sonko peinent à convaincre ?
Le sujet au cœur de l’enquête
En octobre 2022, les autorités libériennes, appuyées par des partenaires étrangers, saisissent à Monrovia 520 kg de cocaïne dissimulés dans un conteneur de produits surgelés, une cargaison estimée à 100 millions de dollars, soit, selon des estimations contemporaines, près d’un cinquième du budget annuel du pays. Sept mois plus tard, le 18 mai 2023, un jury populaire de la Cour criminelle « C » acquitte les quatre prévenus. L’appel du gouvernement échoue et l’affaire se mue en crise de confiance : suspects introuvables dans l’immédiat, querelle ouverte entre l’Exécutif et la magistrature, soupçons de corruption judiciaire. Cette enquête revient sur les faits, les zones d’ombre de la procédure et les effets systémiques d’un dossier devenu emblématique des failles de l’État de droit en Afrique de l’Ouest.
Les faits établis
La saisie résulte d’un renseignement international : des services américains et brésiliens signalent un conteneur suspect en partance d’Amérique du Sud vers le Liberia. À l’arrivée, le conteneur (officiellement des « pieds de porc » ou autres denrées surgelées) est dirigé vers l’entrepôt de TRH Trading, grand importateur de produits alimentaires. Les enquêteurs y découvrent 520 kg de cocaïne. Quatre hommes sont interpellés pour avoir tenté, selon l’accusation, de « prendre possession » de la marchandise et d’acheter le conteneur à un prix sans commune mesure avec sa valeur commerciale : un Libérien (Oliver Zayzay), un Bissau-Guinéen (Adulai Djibril Djalo), un Libanais (Makki Ahmed Issam) et un ressortissant présenté comme guinéen/portugais (Malam Conte). L’acte d’accusation retient notamment le blanchiment, la détention et l’importation non autorisées de stupéfiants et l’association de malfaiteurs. Le procès s’ouvre début 2023 et, contre toute attente, s’achève par un acquittement unanime ; le tribunal ordonne en outre la restitution d’environ 200 000 $ saisis lors des arrestations. Le 31 mai 2023, la Cour suprême rejette la tentative du ministère de la Justice de suspendre l’application du verdict.
Zones d’ombre et angles morts procéduraux
Plusieurs fragilités ressortent des audiences et des décisions. D’abord, la qualification pénale : Le juge président a ultérieurement considéré que les accusations étaient disproportionnées par rapport aux preuves présentées, pointant une stratégie de poursuite mal calibrée. Ensuite, la chaîne de possession : le conteneur avait été délivré à l’entrepôt de TRH Trading sans inspection renforcée malgré des alertes maritimes, et l’arrestation aurait été effectuée avant toute « remise contrôlée » de la marchandise aux suspects, facilitant la défense consistant à plaider la simple venue pour récupérer des aliments congelés. Enfin, un hiatus financier a nourri le doute : alors que l’accusation évoquait environ 200 000 $ saisis à l’un des prévenus, le tribunal n’a vu produire que 113 000 $, le solde restant mystérieux. Ces incohérences, cumulées, ont vraisemblablement pesé dans l’esprit du jury.
Soupçons et climat de défiance
L’après-verdict a pris une tournure chaotique. Dans les jours qui suivent, les autorités reconnaissent « avoir perdu la trace » des quatre acquittés, avant qu’ils ne réapparaissent pour réclamer la restitution de l’argent. Le ministre de la Justice qualifie la décision d’« affligeante » et s’interroge publiquement sur la pertinence du système de jury, estimant qu’il alimente des perceptions d’« une justice compromise ». Cette sortie lui vaut une procédure d’outrage devant la Cour suprême, signe d’une fracture institutionnelle. Parallèlement, des allégations, certes non démontrées, de tentatives de corruption de jurés circulent dans la presse et sur les réseaux sociaux ; la justice convoque même un média pour un article évoquant un « arrosage » de 500 000 $ autour du jury. Officiellement, rien n’a été établi, mais la succession de maladresses de procédure, de querelles publiques et de fuites alimente l’idée d’une justice vulnérable aux influences.
Acteurs, intérêts, stratégies
Le ministère de la Justice, pressé de montrer des résultats face à une opinion inquiète de l’essor des drogues dures, a privilégié une incrimination large mais contestable au regard des éléments matériels. La magistrature, soucieuse d’affirmer son indépendance, a tenu bon sur l’acquittement, tout en renvoyant la responsabilité des failles probatoires vers l’Exécutif. Les quatre prévenus, défendus par des avocats aguerris, ont exploité les brèches : absence de leurs noms sur le connaissement, défaut d’inspection au port, absence de remise contrôlée, incertitude sur les sommes saisies. Les partenaires internationaux, enfin, oscillent entre satisfaction devant la saisie initiale (preuve d’une coopération efficace) et inquiétude après l’acquittement, inquiétude exprimée publiquement par l’ambassade des États-Unis.
Mise en perspective : un carrefour du trafic sous pression
L’affaire libérienne s’inscrit dans une reconfiguration des routes de la cocaïne : production mondiale record, demande soutenue en Europe, et détournement de flux via l’Afrique de l’Ouest. Les rapports de l’ONUDC documentent l’intensification des saisies au Sahel et sur les façades atlantiques depuis 2019. Des travaux récents décrivent aussi l’ancrage croissant de groupes criminels des Balkans occidentaux, en lien avec des cartels sud-américains, dans la logistique portuaire ouest-africaine. Le Liberia, pays côtier au système portuaire en croissance mais aux capacités de contrôle limitées, devient, comme ses voisins, un territoire de transit exposé : en février 2025, une saisie de plus de 200 kg à la frontière de Bo Waterside a encore rappelé l’actualité du risque.
Effets sur la crédibilité des institutions
À court terme, l’Exécutif a fait adopter puis promulguer, en juillet 2023, une loi renforçant les incriminations et durcissant le régime de la détention provisoire pour les trafiquants. Ce sursaut législatif a une portée symbolique et peut fermer certaines échappatoires procédurales (régime de la preuve, régime de la caution), mais il ne répond pas aux griefs centraux mis à nu par le procès : qualité de l’enquête, intégrité de la chaîne de possession, cohérence des charges, gouvernance du jury. Tant que ces maillons faibles persisteront, la rhétorique répressive restera, aux yeux du public, un plâtre sur une jambe de bois. La bataille judiciaire autour de la restitution des fonds a, elle aussi, écorné l’image d’un État capable d’appliquer sereinement ses propres décisions.
Image internationale et coopération
L’épisode a nourri une narration embarrassante : un pays salué pour une saisie record se retrouve incapable de sécuriser une condamnation dans un dossier jugé « emblématique » par ses partenaires. Les prises de position publiques de l’ambassade américaine, ses félicitations au moment de la saisie, et sa « tristesse » après l’acquittement, traduisent ce balancement entre encouragement et doute. Dans une région où le trafic de cocaïne finance parfois des acteurs armés, ces signaux pèsent sur la crédibilité du Liberia auprès des bailleurs et agences d’entraide judiciaire. Pour un État qui dépend de coopérations techniques et financières, l’enjeu dépasse de loin ce seul dossier.
Quelles leçons pour la lutte anti-drogue ?
Trois enseignements se dégagent. D’abord, l’enquête doit précéder la communication : privilégier des opérations « pilotes » juridiquement solides (remise contrôlée, filatures, saisies documentées, appui forensique) plutôt que des coups d’éclat fragiles en droit. Ensuite, l’intégrité procédurale est un impératif : sécurisation des pièces à conviction, traçabilité des espèces saisies, contrôle contradictoire et exploitation systématique des outils d’alerte maritime. Enfin, il faut traiter le « facteur jury » : si le procès par jurés est maintenu, la prévention du subornement (séquestration stricte des jurés, sanctions renforcées, suivi patrimonial) et la pédagogie probatoire (présentations claires, démonstrations matérielles) deviennent stratégiques.
Conclusion
L’acquittement des prévenus dans « l’affaire des 100 M$ » ne dit pas nécessairement que la justice libérienne est irrémédiablement « compromise ». Il révèle en revanche, avec brutalité, un écosystème judiciaire et policier où les défaillances techniques, la porosité institutionnelle et les perceptions de corruption suffisent à rendre inopérants des efforts pourtant réels de coopération internationale. La réponse adéquate ne tient pas dans la seule sévérité des lois, mais dans une reconquête patiente de la qualité probatoire, de l’intégrité des procédures et de la confiance, conditions minimales pour que la lutte contre le narcotrafic en Afrique de l’Ouest cesse d’être un exercice de Sisyphe.