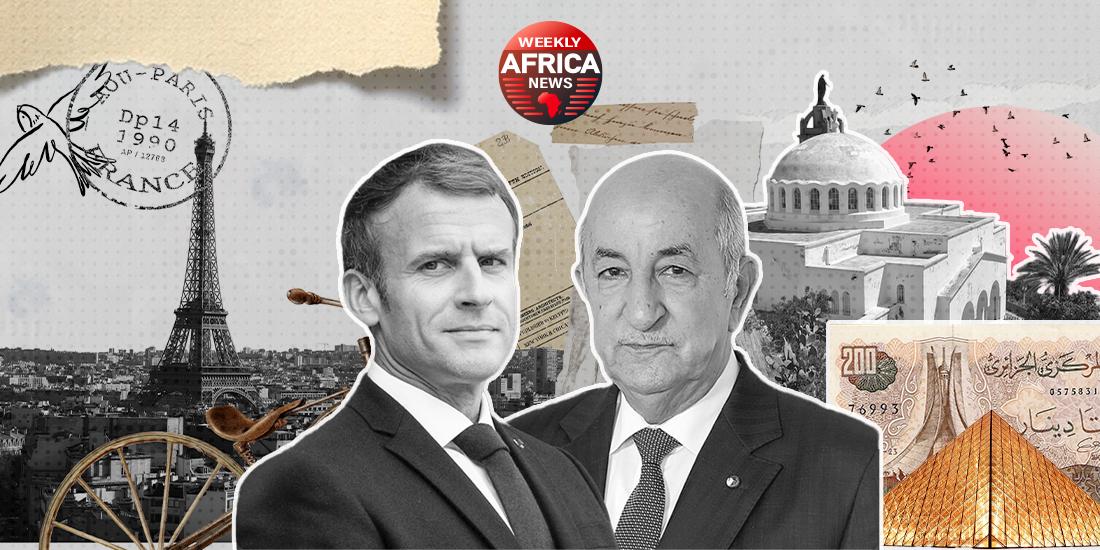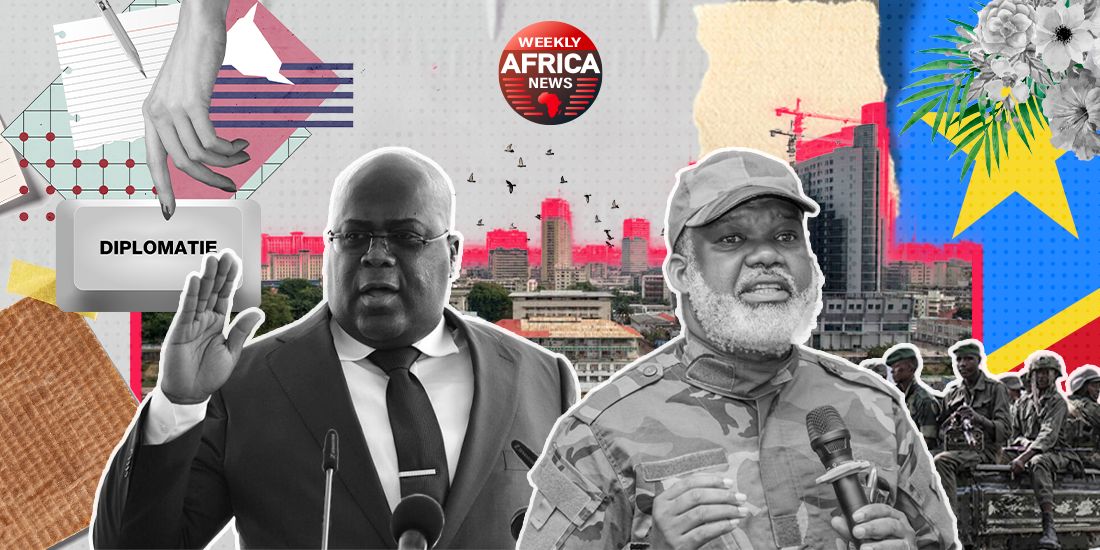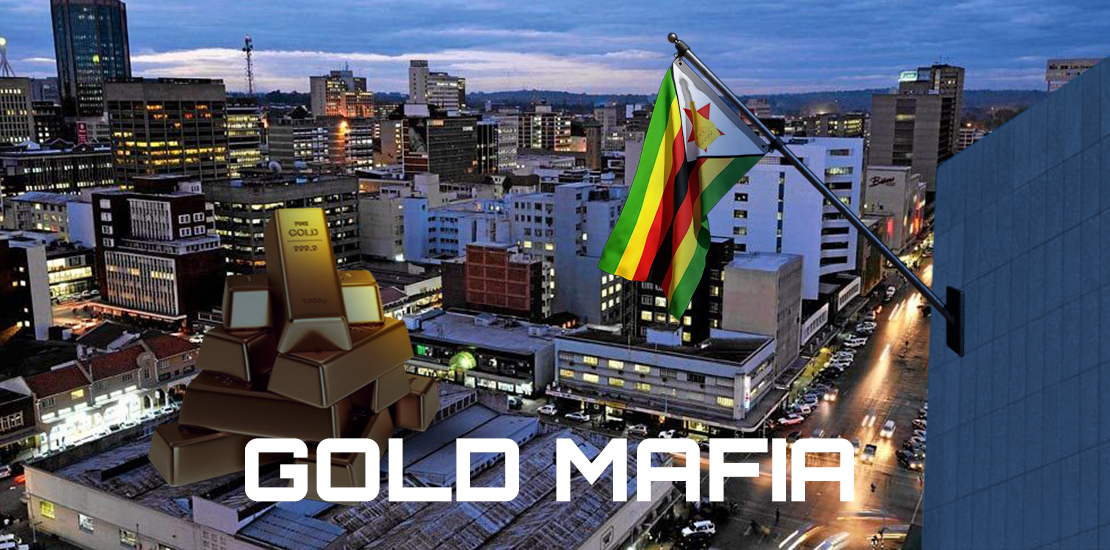Agrobusiness au Sénégal : Pourquoi les promesses de Faye et Sonko peinent à convaincre ?
Il y a des appels au sursaut qui relèvent de la responsabilité, et d’autres qui flirtent avec la déflagration. La récente vidéo d’Essossimna Marguerite Gnakadé – son « appel à la reconstruction » – appartient à la seconde catégorie. « Le temps du silence est terminé », clame l’ancienne ministre des Armées. Fort bien. Mais l’heure n’est pas au saut dans l’inconnu. Derrière la rhétorique de la “libération” transparaît une stratégie du choc : fabriquer l’urgence, précipiter le pays dans une bataille de clochers, déplacer la conflictualité au cœur même de l’appareil d’État. La politique ne se résume pas à renverser la table : elle consiste d’abord à ne pas faire basculer la nation.
Les faits, eux, sont têtus. Nommée en octobre 2020 sans expérience militaire préalable, première femme à ce poste, Gnakadé a été démise en décembre 2022 ; le portefeuille a été aussitôt rattaché à la présidence. Les décrets n’ont pas livré de motifs officiels, mais l’hypothèse d’un défaut de commandement a circulé. Plus tôt, en 2018, elle quittait la direction de la BTCI « sur fond de controverse autour de sa gestion », épisode jamais éclairci. Deux séquences, un même fil rouge : l’opacité. On peut s’autoproclamer rassembleuse ; encore faut-il assumer ses zones d’ombre et répondre aux questions élémentaires sur son propre bilan.
Que propose-t-elle aujourd’hui ? Rien de moins que la démission immédiate du Président Faure Gnassingbé, une « transition inclusive » dont on chercherait en vain l’architecture et un appel appuyé aux forces armées pour « se ranger du côté du peuple ». Traduisons : créer un vide politique et sommer l’institution militaire d’en devenir l’arbitre. Dans un pays où, fin juin, la rue s’est embrasée, jouer l’embrasement comme levier de pouvoir n’est pas du courage : c’est du cynisme. La paix civile n’est pas une variable d’ajustement pour relancer une carrière.
On juge une alternative à l’épreuve de la méthode. Or, rien : pas de feuille de route constitutionnelle, pas de garde-fous juridiques, pas de calendrier, pas de dispositif de sécurité pour traverser l’entre-deux. Beaucoup de mots, aucun mode d’emploi. Et cette antienne, « protéger, non réprimer », brandie comme sésame moral : en pratique, une façon de convoquer les uniformes dans l’arène politique. L’histoire récente de la région parle d’elle-même : quand les casernes deviennent tribunaux, la souveraineté civile se fissure et la stabilité économique s’évapore. Faut-il vraiment importer au Togo les scénarios de l’aventure militaire que d’autres voisins paient encore au prix fort ?
Le trouble s’épaissit à l’examen de sa base militante. Le mouvement qu’elle a fondé – « Jeunes Sans Frontière pour le Développement du Togo » – a enchaîné querelles statutaires, accusations d’« imposture » et exclusions contestées. On ne gouverne pas un pays si l’on peine à stabiliser son premier cercle. Gouverner, c’est bâtir des institutions qui survivent aux humeurs des chefs ; pas diriger des cénacles en scission permanente. La cohésion ne se décrète pas dans une vidéo virale : elle se prouve par l’ordre, la procédure, la loyauté à des règles.
Reste la question décisive, la plus politique de toutes : qui finance, et selon quelles règles ? Gnakadé affirme que son mouvement vit de cotisations et de dons « internes », parfois de projets avec des partenaires. Très bien. Mais où sont les comptes certifiés, la liste des donateurs, les audits indépendants ? Ni sa sortie du 17 août, ni ses tribunes antérieures ne s’accompagnent d’un budget, d’un comité financier, d’un mécanisme de conformité. Dans une région saturée de circuits opaques – diasporas politisées, mécènes intéressés, officines – l’absence de transparence n’est pas un détail : c’est une alerte. Celui qui réclame la “refondation” commence par ouvrir ses livres.
On objectera que la stabilité n’est pas un programme. C’est pourtant, en 2025, un préalable. Le Nord subit des incursions djihadistes répétées ; des soldats tombent ; des civils sont visés ; l’État déploie des dispositifs d’urgence et de résilience pour contenir la menace et maintenir l’activité. On peut débattre des réformes politiques, mais on ne peut pas nier que la sécurité physique conditionne la survie des plus modestes. Face à cette réalité, la “thérapie de choc” prônée par l’ancienne ministre relève de l’aventure : un pari à somme négative où l’on hypothèque la paix sociale contre un slogan.
Il y a, enfin, une contradiction morale. Celle qui fut hissée à un ministère régalien par la confiance du chef de l’État se pose en contemptrice de « l’ordre ancien », sans jamais éclairer son propre parcours. La loyauté n’interdit pas l’émancipation ; elle oblige à la vérité. Où sont les explications sur la BTCI ? Où sont les raisons détaillées du limogeage aux Armées ? Où sont les évaluations indépendantes de ses actions ? Silence. On ne reconstruit pas une République sur des angles morts.
Conclusion nette : sans clarification de son passage à la BTCI, sans explication des motifs de son éviction aux Armées, sans comptes ouverts et audits sur ses sources de financement, sans plan de transition techniquement soutenable, l’ambition de Marguerite Essossimna Gnakadé n’est pas une offre politique ; c’est un risque systémique. La stabilité, celle que le pouvoir en place assure et que tant de voisins ont perdue, n’est pas un gros mot. C’est la condition pour que les réformes deviennent possibles.