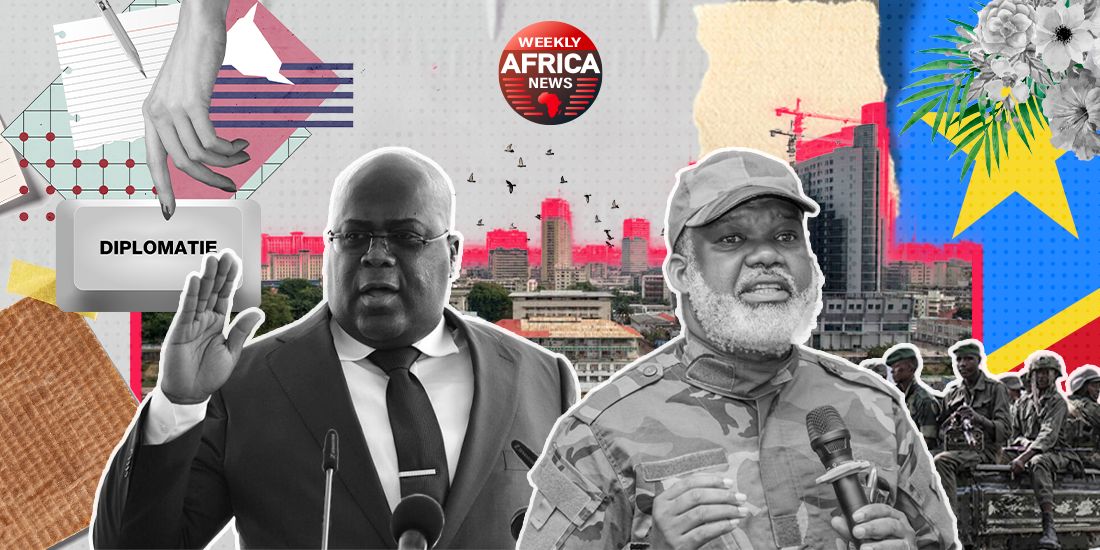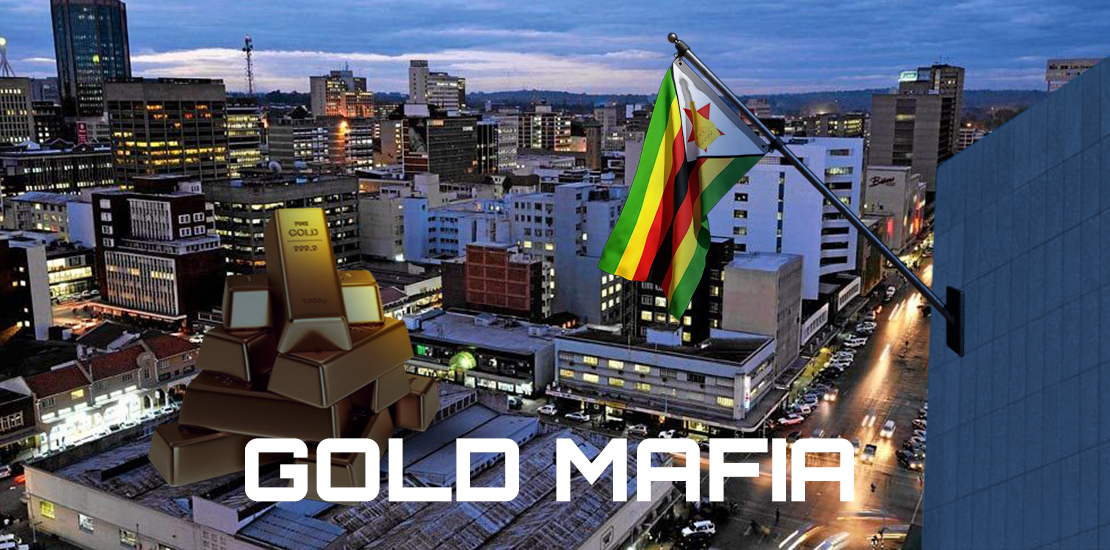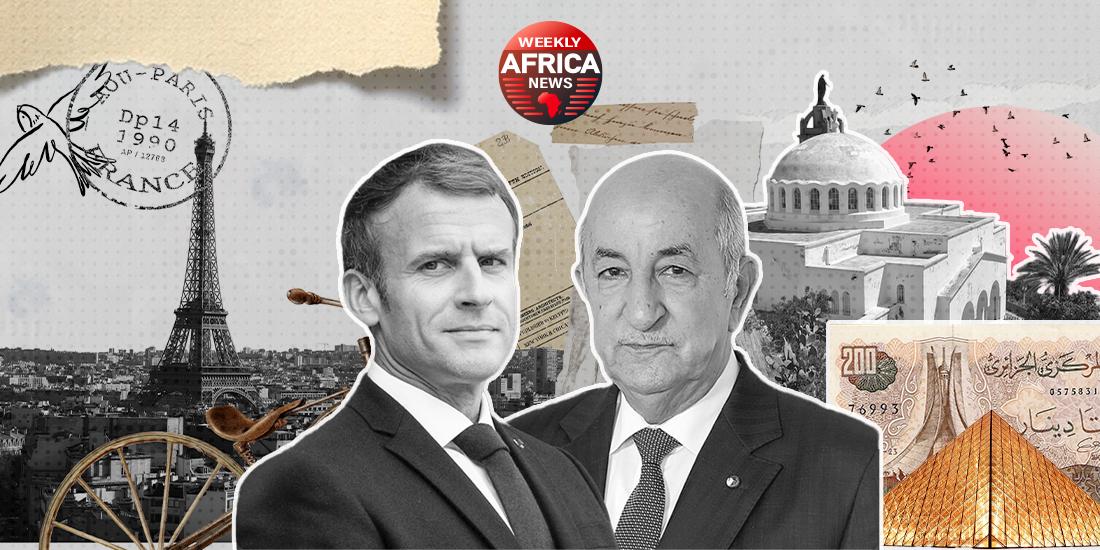Agrobusiness au Sénégal : Pourquoi les promesses de Faye et Sonko peinent à convaincre ?
Derrière le vernis technologique se trament d’intenses négociations entre États africains, les banques et la France.
Dans les capitales d’Afrique de l’Ouest, l’idée d’un « franc CFA numérique » circule à bas bruit depuis plusieurs années. Officiellement, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) modernise d’abord les rails de paiement : le 30 septembre 2025, elle a lancé une plateforme régionale de paiement instantané (PI-SPI) interopérable entre banques, établissements de monnaie électronique et microfinances. Mais derrière l’amélioration des infrastructures, une question politique demeure : qui écrira les règles d’une éventuelle monnaie numérique de banque centrale (MNBC) libellée en franc CFA, et selon quels équilibres entre États de l’Union, Paris et les acteurs financiers ?
Le cœur du dossier est double. D’un côté, la BCEAO a soufflé le chaud et le froid : démentis répétés face aux rumeurs d’un « e-CFA », puis signaux que l’institution étudiait bien une MNBC comme complément à la monnaie électronique et au mobile money. De l’autre, la réforme de 2019 entre l’UEMOA et la France a mis fin au dépôt obligatoire d’une partie des réserves au Trésor français et promis le passage à l’« Eco », sans remettre en cause la parité fixe à l’euro ni la garantie de convertibilité. Toute version numérique du franc CFA devrait donc continuer de s’inscrire dans ce cadre, ce qui explique les sensibilités : l’architecture d’un jeton de banque centrale, ses modalités de règlement en euros et les garde-fous prudentiels impliquent de facto des interactions techniques et juridiques avec Paris et Francfort.
La modernisation des paiements est tangible. PI-SPI doit permettre des transferts 24/7, des alias et QR codes, avec une première cohorte d’établissements homologués. Lors de la cérémonie de lancement, le gouverneur Jean-Claude Kassi Brou a présenté l’ambition de faire du paiement numérique « un bien public ». Dans le même temps, l’écosystème privé s’est densifié : la zone UEMOA compte des dizaines de millions de comptes de monnaie électronique et mise sur GIM-UEMOA et sa plateforme GIMpay pour porter l’interopérabilité commerciale et publique (collecte fiscale, e-commerce). Cette séquence renforce l’argument des tenants du « rails first, currency later » : tant que l’instantané domestique et transfrontalier progresse, le bénéfice marginal d’une MNBC de détail serait limité.
Les banques, elles, avancent en ordre dispersé. Les filiales de groupes français (BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole) défendent des modèles où l’intermédiation reste centrale : conformité, lutte contre la fraude, gestion de liquidité en euros et accès au marché correspondent-banque. Les champions panafricains (Ecobank, UBA) et les émetteurs de monnaie électronique affiliés aux télécoms souhaitent que le schéma cible ne cannibalise pas leurs volumes ni ne renchérisse la conformité. Un e-CFA « compte-à-compte » géré directement par la banque centrale atteindrait leurs revenus sur les paiements de détail ; à l’inverse, un modèle « intermédié » où banques et fintechs tiennent les portefeuilles clients, préserverait leurs rôles tout en standardisant l’accès au cash numérique. Le précédent nigérian pèse dans les arbitrages : l’eNaira, première MNBC africaine, a connu une adoption faible, rappelant qu’un jeton public ne se décrète pas contre des solutions privées déjà massivement utilisées.
À Paris, la Banque de France a multiplié les expérimentations de MNBC de gros (wholesale) depuis 2020 : règlements-livraisons de titres, paiements transfrontaliers, interactions avec SWIFT. De son côté, la Banque centrale européenne avance sur un euro numérique de détail « complément des espèces ». Pour les États de l’UEMOA, l’intérêt est clair : ancrer la convertibilité et les règlements transfrontaliers dans une couche de banque centrale moderne, capable d’interopérer avec l’euro numérique et les systèmes de règlement en titres. Mais l’enjeu politique n’est pas moindre : dans une union monétaire où la parité fixe et la garantie française demeurent, qui décide des paramètres de confidentialité, de plafonds, d’accès hors ligne ? Et comment éviter qu’un franc CFA numérique, techniquement dépendant d’infrastructures européennes, n’alimente la critique d’une souveraineté inachevée ?
Les blocages internes à la CEDEAO compliquent encore l’équation. Le projet de monnaie unique « Eco » a été repoussé à 2027, sans garantie de calendrier. La sortie de l’Alliance des États du Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger) d’ECOWAS fracture la gouvernance régionale et détourne l’attention des chantiers monétaires communs. Or une MNBC franc CFA de détail, si elle voyait le jour avant l’Eco, figerait de facto des choix techniques et juridiques difficiles à reconfigurer dans une future monnaie élargie. Plusieurs responsables plaident donc pour une approche par étapes : d’abord l’instantané et l’interopérabilité de détail (PI-SPI, GIMpay), ensuite des expérimentations de gros (règlement-livraison en monnaie de banque centrale tokenisée), enfin un éventuel déploiement de détail, mais seulement si l’usage le justifie.
Pour les citoyens et les entreprises, les conséquences se jouent sur trois terrains. D’abord le coût : si PI-SPI et les schémas régionaux imposent une tarification basse, la pression concurrentielle peut réduire les frais, MNBC ou non. Ensuite la sécurité et la confidentialité : un jeton de banque centrale peut offrir une « monnaie publique » numérique, mais ses réglages (traçabilité, plafond de détention, KYC) sont politiques. Enfin l’intégration régionale : la valeur d’une MNBC augmente avec l’acceptation transfrontalière ; sans accords efficaces avec le Nigeria (eNaira), le Ghana (eCedi) et l’UE (euro numérique), l’avantage resterait domestique.
Le « scandale silencieux » n’est pas celui d’un projet clandestin : il tient à l’opacité des arbitrages. Entre démentis et signaux d’étude, entre rails de paiement très concrets et promesses monétaires sans échéance, les opinions publiques perçoivent des intentions contradictoires. Les intérêts bancaires poussent à préserver un modèle intermédié ; les États veulent alléger la dépendance opérationnelle à l’Europe sans affaiblir la parité ; Paris cherche la cohérence avec l’euro numérique et la stabilité financière. Tant que ces tensions ne sont pas clarifiées, l’espace sera occupé par les solutions privées qui, elles, avancent.
La BCEAO dispose pourtant d’une fenêtre d’opportunité. En consolidant PI-SPI, en publiant une feuille de route graduelle et transparente (expérimentations de gros, critères d’un éventuel pilote de détail, articulation avec l’Eco), et en organisant la concertation avec banques, fintechs et Trésors, l’Union peut lier modernisation des paiements et souveraineté monétaire. L’objectif n’est pas de cocher la case MNBC, mais de résoudre un problème concret : des paiements plus rapides, moins chers et sûrs, dans un cadre régional lisible. À cette condition, le franc CFA numérique cessera d’être un objet de suspicion pour devenir, peut-être, un outil.