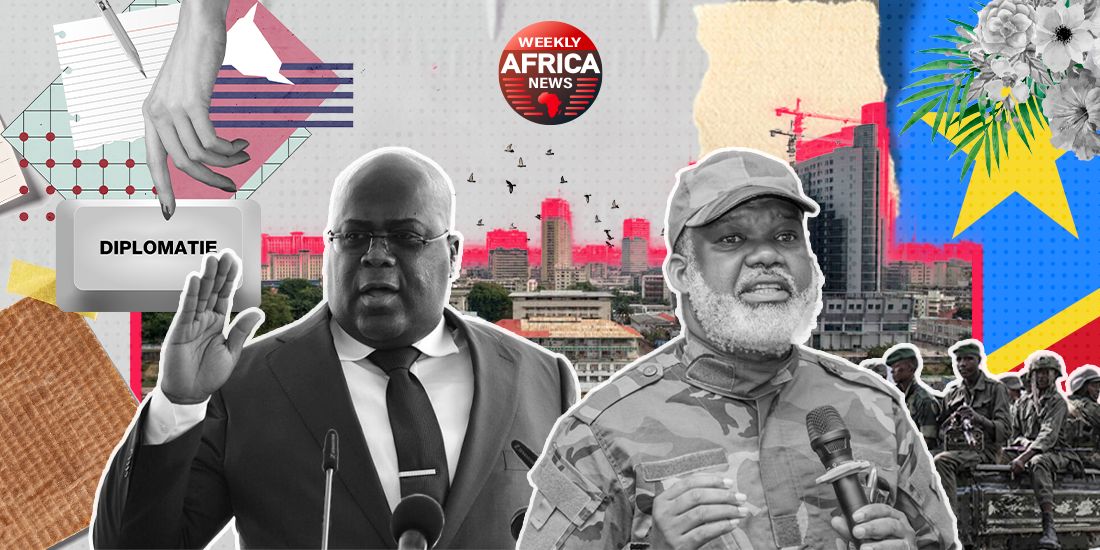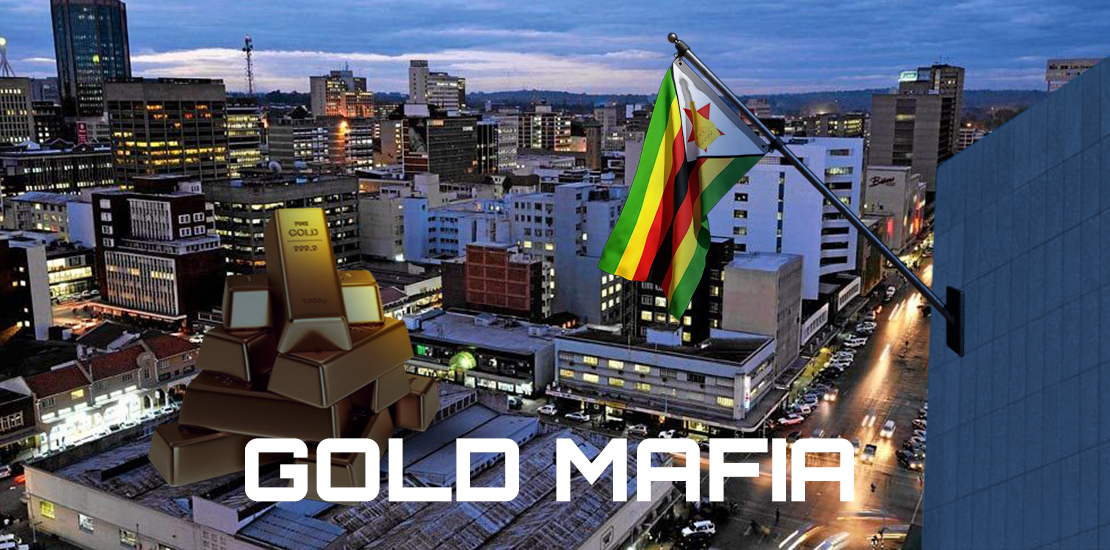Agrobusiness au Sénégal : Pourquoi les promesses de Faye et Sonko peinent à convaincre ?
Problème
Depuis le début des années 2000, une part significative des capitaux privés camerounais s’échappe via des montages offshore, sociétés-écrans, holdings, comptes à l’étranger, trusts, qui brouillent l’identité des bénéficiaires effectifs. L’enjeu dépasse la morale publique : il affecte la mobilisation fiscale, l’investissement domestique et la confiance institutionnelle. L’existence d’une structure offshore n’est pas illégale en soi ; c’est l’opacité, et, le cas échéant, l’origine illicite des fonds ou la fraude fiscale, qui pose problème.
Les faits établis
Les grandes fuites de données (Panama, Paradise, Pandora) ont documenté l’usage de « boîtes aux lettres » immatriculées aux îles Vierges britanniques, aux Seychelles ou à Hong Kong, interposant des prête-noms entre le propriétaire réel et ses actifs. Le Cameroun y apparaît : la base « Offshore Leaks » recense des dizaines de personnes et d’adresses liées au pays, révélant un recours récurrent aux intermédiaires (fiduciaires, directeurs « nominee ») et aux cascades d’entités qui diluent la traçabilité. Cette architecture sert à segmenter la propriété, à déplacer les flux et à compliquer toute enquête patrimoniale.
Destinations privilégiées
Trois places reviennent systématiquement. Genève, d’abord : longtemps protégée par le secret bancaire, la Suisse a été un pivot historique du dépôt d’avoirs non déclarés. Les révélations « SwissLeaks » ont montré l’ampleur des comptes privés liés à l’Afrique, tout en rappelant que des raisons légitimes existent (ex. diversification patrimoniale) ; depuis 2017-2018, l’échange automatique d’informations a toutefois resserré l’étau, sans l’abolir pour les pays qui n’y participent pas. Paris, ensuite : la pierre francilienne, via sociétés civiles immobilières et holdings, demeure un véhicule classique d’ancrage d’actifs, dans un marché encore critiqué pour ses failles de transparence (identité des bénéficiaires effectifs, contrôles KYC inégaux chez certains professionnels). Dubaï, enfin, s’est imposée au cours de la dernière décennie comme hub d’accueil de fonds à la recherche de stabilité, de fiscalité douce et de confidentialité immobilière ; les fuites « Dubai Unlocked » ont illustré la place de l’émirat dans le stockage de patrimoines internationaux, y compris africains.
Les mécanismes
Au-delà des holdings et trusts, deux canaux sont centraux :
- La sur/sous-facturation commerciale (« trade misinvoicing »), notamment dans les filières extractives et forestières, qui déplace discrètement des marges à l’étranger via des prix de transfert biaisés, des écarts de valeur déclarée à l’export et des sociétés liées situées en juridictions opaques.
- L’empilement d’entités (BVI → Dubaï → Luxembourg par exemple), avec des administrateurs professionnels, qui fragmente les indices patrimoniaux entre banques, registres et notaires et allonge la chaîne probatoire. À l’issue, les fonds se matérialisent souvent en immobilier de prestige (appartements, villas, résidences de services) facile à gager, à louer et à revendre.
- Mise en perspective. L’Afrique perd autour de 88–89 milliards $ par an du fait des flux financiers illicites, un ordre de grandeur proche de la moitié du déficit de financement des ODD sur le continent. Les travaux académiques sur la fuite des capitaux montrent un lien robuste avec la faiblesse institutionnelle, les rentes de ressources et le surendettement : plus la gouvernance est perçue comme fragile, plus l’incitation à externaliser l’épargne privée augmente. Le Cameroun, économie mixte et exportatrice de matières premières, n’échappe pas à ces dynamiques – en particulier dans les périodes de tension budgétaire et de volatilité des cours.
Acteurs, intérêts, stratégies
– Propriétaires finaux : sécuriser l’épargne hors risque domestique, optimiser la charge fiscale, protéger la succession.
– Intermédiaires (cabinets d’avocats, fiduciaires, agents immobiliers, banques privées) : fournir des structures « clé en main » et des solutions de conformité minimales.
– Juridictions d’accueil : attirer des flux légaux et des acheteurs immobiliers, soutenir des écosystèmes de services haut de gamme.
– État d’origine : contrer l’érosion de l’assiette fiscale, préserver l’épargne domestique pour l’investissement, afficher des résultats anticorruption.
Ces stratégies s’ajustent à la réglementation : par exemple, le durcissement suisse a déplacé une partie des flux vers l’immobilier du Golfe ; en Europe, la fermeture ou la restriction d’accès aux registres publics des bénéficiaires effectifs a créé de nouvelles zones d’ombre pour les enquêteurs et la société civile.
Impact pour l’économie camerounaise
La fuite de capitaux exerce un double effet ciseaux. D’un côté, elle soustrait une épargne qui pourrait financer l’industrie locale, les infrastructures ou l’innovation. De l’autre, elle réduit l’effort fiscal supporté par les contribuables les mieux dotés, pesant davantage sur la consommation et les PME. Or, la pression fiscale au Cameroun reste inférieure à la moyenne africaine : autour de 14 % du PIB en 2022, contre environ 16 % en moyenne pour les pays africains couverts par les statistiques comparables. À l’échelle microéconomique, l’éviction de l’investissement privé « patient » se traduit par des chantiers inachevés, des retards de maintenance et une productivité bridée. À l’échelle macro, elle alimente le recours à la dette publique, parfois elle-même mal allouée, bouclant un cercle vicieux.
Réponses publiques et limites
Le Cameroun a engagé des campagnes anticorruption et adopté des obligations de déclaration des bénéficiaires effectifs auprès de l’administration fiscale. Dans le secteur extractif, l’Initiative pour la transparence (EITI) a stimulé la divulgation, même si la mise en œuvre reste heurtée et que la publicité des registres demeure incomplète. Au plan international, l’échange automatique d’informations et les standards OCDE ont réduit certains angles morts, mais l’efficacité dépend de l’adhésion des contreparties, du périmètre des données échangées et des capacités d’exploitation par les administrations.
Ce qui changerait la donne
Trois leviers se détachent :
- Transparence effective des bénéficiaires effectifs (registre interopérable, accès contrôlé mais opérationnel pour presse/ONG, sanctions en cas de fausse déclaration).
- Police des valeurs à l’export (appui douanier et statistique pour détecter les écarts de prix, contrôles sur parties liées, coopération avec les grandes places négociantes).
- Traçabilité immobilière dans les hubs d’accueil (déclaration obligatoire de l’ayant droit réel à l’achat, vigilance accrue des notaires/agents, échanges d’information transfrontaliers).
En définitive, l’enjeu des fortunes offshore camerounaises n’est pas seulement d’« attraper des fraudeurs », mais de réconcilier épargne privée et intérêt général. Tant que la combinaison « opacité + mobilité du capital » restera plus rentable que « investir chez soi », la fuite perdurera. À l’inverse, une transparence crédible, des institutions prévisibles et des rendements domestiques compétitifs sont les meilleurs antidotes. C’est à ce prix que l’argent qui dort à Genève, se valorise à Paris ou scintille à Dubaï pourra, demain, travailler à Douala, Yaoundé ou Garoua.