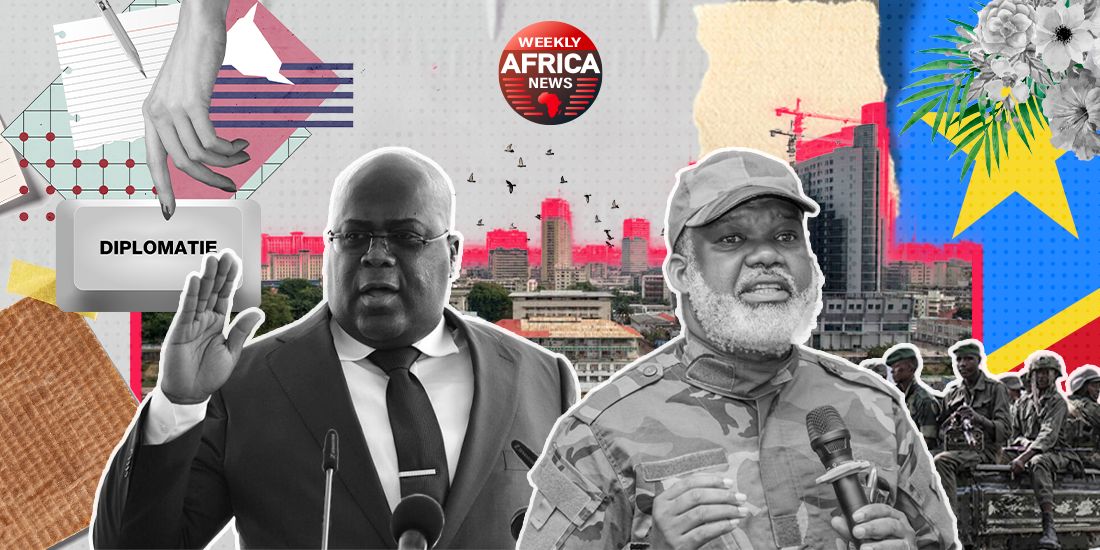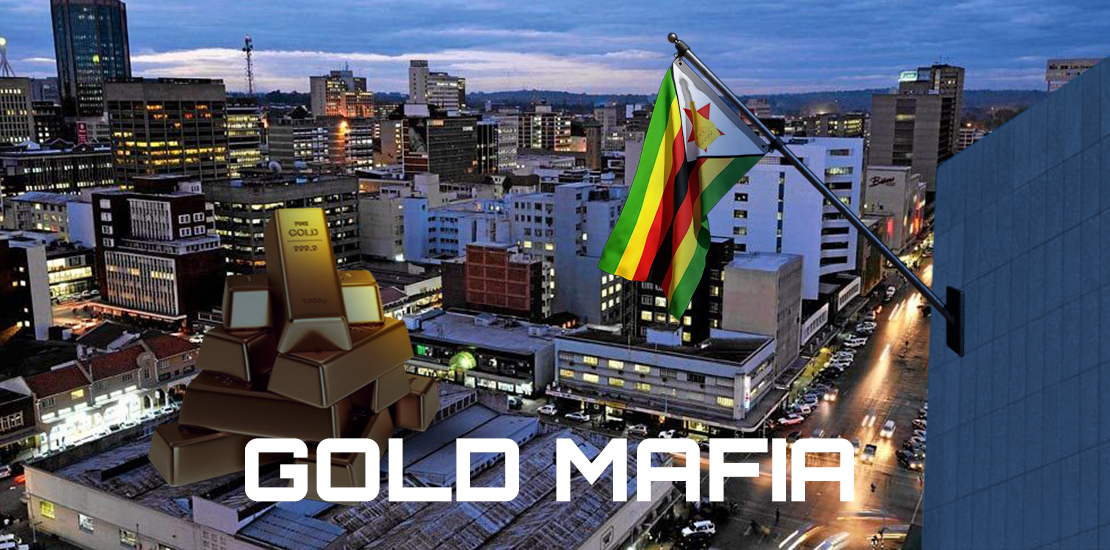Agrobusiness au Sénégal : Pourquoi les promesses de Faye et Sonko peinent à convaincre ?
Le 31 janvier 2025, le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone a condamné Trafigura pour corruption d’agent public étranger en lien avec des contrats pétroliers en Angola. L’ex-directeur des opérations Mike Wainwright a écopé de 32 mois de prison (dont une partie avec sursis). L’entreprise a été condamnée à une amende de 3 millions de francs suisses et sommée de provisionner 145 millions de dollars en vue d’éventuelles créances compensatoires. C’est une décision inédite en Suisse pour un géant du négoce de matières premières, même si les prévenus conservent la possibilité d’un appel.
Au cœur du dossier : des paiements illicites effectués entre 2009 et 2011 pour s’assurer l’accès à des contrats de transport maritime et d’avitaillement conclus avec la compagnie nationale Sonangol. L’acte d’accusation suisse décrit des versements d’environ 4,3 millions d’euros, complétés par 604 000 dollars en liquide remis en Angola, au bénéfice de Paulo Gouveia Jr, responsable de Sonangol Distribuidora. Les flux ont transité par un réseau d’intermédiaires et de sociétés-écrans, dont ConsultCo Trading Ltd, autour d’un ex-salarié affublé du surnom « Mr Non-Compliant ». Le schéma aurait permis d’obtenir notamment huit affrètements de navires et un contrat de soutage.
Les audiences ont éclairé le fonctionnement interne du négociant. L’ancien directeur financier Pierre Lorinet a reconnu que de « grosses » factures d’intermédiaires n’avaient pas fait naître de « red flags » à l’époque, compte tenu des procédures contractuelles internes. La défense a insisté sur l’existence de dispositifs de conformité jugés, selon l’entreprise, « conformes aux pratiques de l’époque ». Les juges ont pourtant estimé que Trafigura n’avait pas pris « toutes les mesures organisationnelles raisonnables et nécessaires » pour prévenir la corruption, franchissant ainsi un seuil symbolique de responsabilité pénale de l’entreprise.
Pour comprendre la portée de l’affaire, il faut rappeler la place de Trafigura dans l’économie pétrolière angolaise au tournant des années 2010. Le négociant a bâti un vaste réseau de distribution via Pumangol (filiale de Puma Energy), tout en contrôlant de facto une grande part des importations de produits raffinés, un marché alors évalué à plusieurs milliards de dollars par an. En 2012, Trafigura a cédé 20 % de Puma Energy à Sonangol, scellant une alliance stratégique au sommet de la chaîne pétrolière nationale. En 2021, les partenaires ont finalement démantelé ces participations croisées : Sonangol a repris les actifs angolais de Puma Energy, tandis que Trafigura rachetait la part de Sonangol dans Puma Energy au niveau global.
Cette intimité entre un négociant et les élites politiques et militaires d’un État rentier s’est matérialisée par des actionnariats sensibles. En 2021, Trafigura a versé 390 millions de dollars pour racheter la participation d’un influent général à la retraite, figure de l’entourage présidentiel, dans la structure actionnariale liée à Puma Energy. L’opération, révélée à l’époque par la presse financière, illustre le coût d’un « débouclage » de relations nouées à l’ère dos Santos, lorsque les rentes pétrolières irriguaient un système de privilèges et d’allégeances. Elle documente aussi, en creux, la manière dont la proximité politico-économique peut compliquer l’identification des conflits d’intérêts et des risques de capture réglementaire.
Le dossier suisse éclaire donc un enjeu plus large : la gouvernance des ressources en Angola, pays dont les recettes publiques restent très dépendantes du pétrole. Depuis 2019, l’État a commencé à reconfigurer son architecture institutionnelle en transférant les fonctions de concessionnaire à l’Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), séparant régulation et opérations. Luanda a rejoint l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) en 2022 ; en 2025, l’ITIE a évalué la mise en œuvre angolaise à 63,5 points, signe de progrès mais aussi de marges de manœuvre importantes — notamment sur la divulgation publique et la traçabilité des flux. Parallèlement, le pays investit pour réduire sa dépendance aux importations de carburants (mise en service visée en 2025 de la raffinerie de Cabinda), tout en réformant progressivement des subventions aux carburants fiscalement coûteuses, réformes qui ont déclenché des protestations meurtrières à l’été 2025.
Que dit l’affaire des limites du système judiciaire international ? D’abord, l’asymétrie entre gains et sanctions. Le ministère public suisse a évoqué des profits indus d’environ 143,7 millions de dollars attribuables aux avantages indûment obtenus. L’amende infligée à l’entreprise (3 millions de francs) demeure modeste, même si la réserve de 145 millions pour d’éventuels dommages et intérêts, ordonnée par les juges, en atténue la portée symbolique. Ensuite, la judiciarisation s’étire : plus d’une décennie sépare les faits des décisions, avec des procédures et appels en cascade et une entraide judiciaire qui dépend de la coopération de pays tiers. Enfin, la sophistication des montages — sociétés de conseil dédiées, contrats d’apparence, circuits offshore — complique la preuve et favorise l’imputabilité diffuse.
Cette inertie n’est pas propre à l’Angola. Elle s’inscrit dans un faisceau de cas visant les maisons de négoce : en 2024, Trafigura a par exemple plaidé coupable auprès des autorités américaines pour des faits de corruption au Brésil (Petrobras), révélant la récurrence de pratiques d’entremise et de surfacturation dans des marchés opaques. La jurisprudence helvétique indique toutefois un mouvement de fond : les places de négoce (Genève, Zoug) se dotent d’outils répressifs plus crédibles, au risque de déplacer les risques vers d’autres juridictions moins exigeantes.
Pour les citoyens angolais, les enjeux sont tangibles. Les arrangements opaques renchérissent le coût des produits pétroliers importés, faussent la concurrence et détournent les ressources fiscales qui pourraient financer des services sociaux. Lorsque l’État tente d’assainir le système, en coupant des subventions devenues budgétairement intenables, le choc sur les prix déclenche des tensions sociales et sape la confiance. À l’inverse, la transparence contractuelle, la publication systématique des intermédiaires et bénéficiaires effectifs, et la clarification des rôles entre Sonangol opérateur, l’ANPG régulateur et le ministère de tutelle peuvent réduire l’espace de l’arbitraire. Les bailleurs (FMI, Banque mondiale) soulignent que des réformes de subventions bien calibrées, accompagnées de filets de sécurité, peuvent améliorer l’efficience sans accroître durablement la pauvreté.
Reste la question politique. L’Angola a engagé une séquence de réformes institutionnelles et de désenchevêtrement entre intérêts publics et privés. Mais l’héritage d’une économie de rentes, la concentration du négoce entre quelques acteurs globaux et la fragilité des contrôles internes rendent les dérives toujours possibles. L’arrêt de Bellinzone n’épuise pas l’affaire : il rappelle plutôt une évidence démocratique, là où la richesse collective est négociée dans l’ombre, la tentation de la capture est maximale. La consolidation de l’ANPG, la privatisation partielle et transparente de Sonangol, l’ouverture de la logistique et de la distribution à une concurrence effective, la publication proactive des contrats et la surveillance citoyenne, appuyée par des normes internationales, seront les véritables marqueurs d’un changement de cap durable.
Conclusion
L’affaire Trafigura en Angola a valeur de révélateur : elle met à nu la vulnérabilité d’un secteur stratégique aux influences privées, documente la faiblesse des garde-fous internes des multinationales et teste la capacité des juridictions du Nord à sanctionner des faits commis au Sud. Les condamnations prononcées en Suisse, les détails du schéma de pots-de-vin et la cartographie des intérêts en jeu forment un récit cohérent : sans transparence contractuelle, séparation stricte des fonctions et contrôle citoyen, la rente pétrolière reste un instrument de pouvoir plutôt qu’un levier de développement. À Luanda comme à Genève, la prévention par la gouvernance coûtera toujours moins cher que la réparation par les tribunaux.