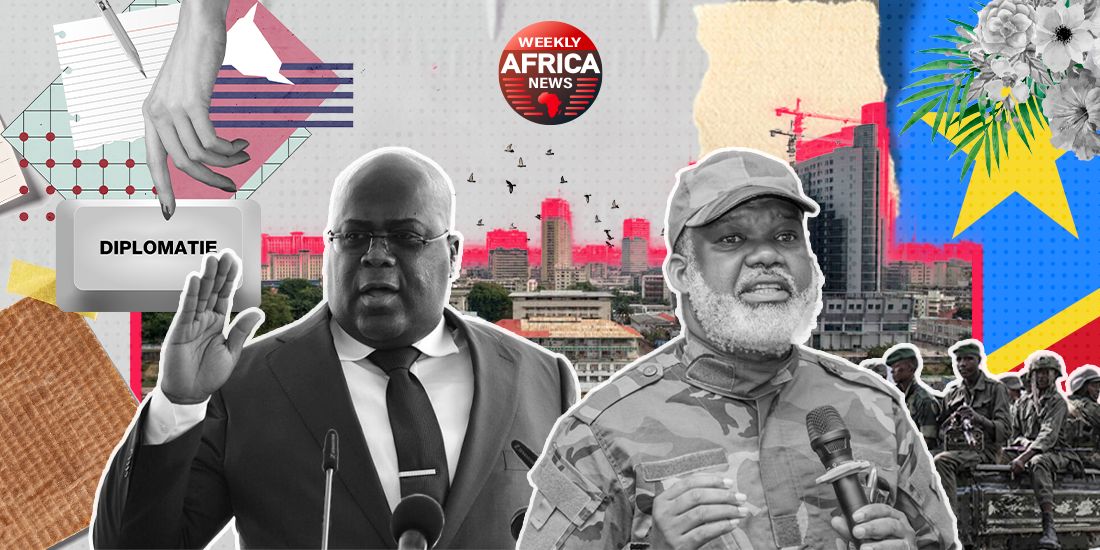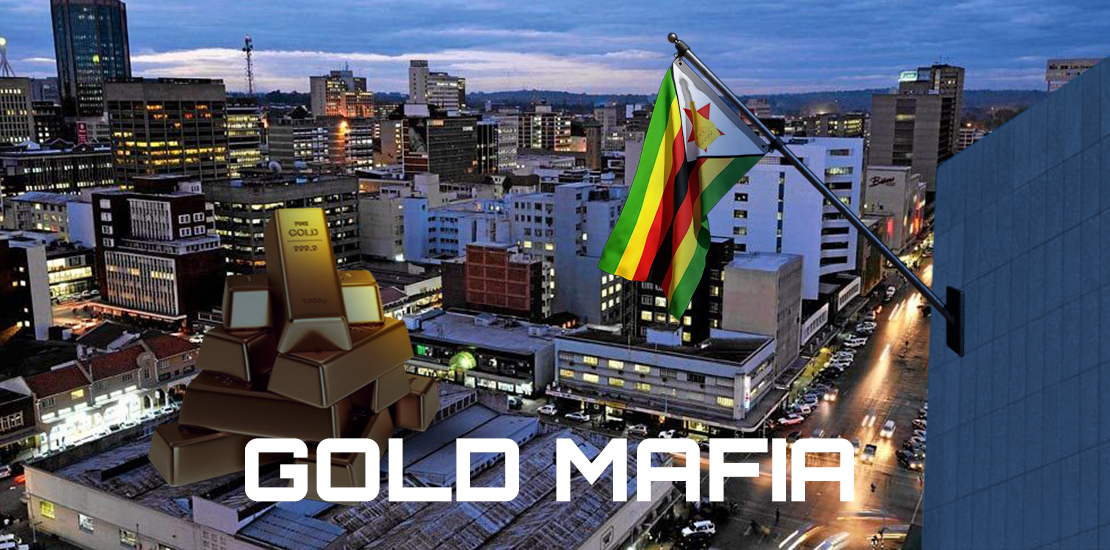Agrobusiness au Sénégal : Pourquoi les promesses de Faye et Sonko peinent à convaincre ?
Un collectif d’organisations africaines et françaises a saisi le Parquet National Financier (PNF) d’une plainte visant le groupe Bolloré et plusieurs de ses dirigeants. Au cœur du dossier : la manière dont des concessions portuaires ont été acquises et exploitées en Afrique de l’Ouest, des soupçons de corruption et, plus largement, des méthodes présumées d’influence politique. Les plaignants réclament la restitution de bénéfices qu’ils estiment indûment perçus, en s’appuyant sur un mécanisme français de restitution des avoirs confisqués, adopté en 2021. Derrière la procédure, un enjeu dépassant les seuls tribunaux : la souveraineté économique des États portuaires et la perception internationale de la gouvernance en Afrique.
Le cœur du litige : des concessions contestées et un “système d’influence” allégué
Les ONG affirment que le groupe a constitué, pendant des années, une position dominante sur des terminaux stratégiques, de Lomé à Conakry, en combinant expertise logistique, relations politiques et communication. Leur plainte évoque un « système » au sein duquel l’obtention et la conservation de concessions auraient reposé sur des pratiques illégales. L’objectif déclaré est la « restitution de milliards d’euros » aux « États et populations victimes », au motif que ces gains dériveraient en partie de contrats viciés. Les plaignants résument la thèse par une formule accusatoire : Bolloré serait « au cœur d’un système de corruption africain ».
Dans ce récit, la communication politique joue un rôle pivot : des campagnes électorales auraient bénéficié de prestations préférentielles de la filiale Havas, sous-facturées, créant une dette politique susceptible d’être “réglée” par l’attribution ou la prolongation de concessions portuaires. Une ONG résume : Havas aurait « sous-facturé ses services de conseil politique » ; en contrepartie, « la concession du port » aurait été sécurisée. Ces assertions rejoignent un dossier pénal déjà ancien sur le Togo et la Guinée, dans lequel magistrats et enquêteurs ont tenté d’établir le lien entre conseil politique et profits logistiques.
L’historique judiciaire : entre transactions, renvois requis et contentieux connexes
En 2021, la société Bolloré a conclu une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) auprès du PNF, avec une amende de 12 millions d’euros, ce qui a clos la procédure contre la personne morale sans reconnaissance de culpabilité pénale. La tentative parallèle de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) visant Vincent Bolloré et deux cadres a, elle, été refusée par le tribunal, ouvrant la voie à un possible procès. En 2024, le PNF a demandé le renvoi de Vincent Bolloré en correctionnelle pour « corruption d’agent public étranger » et « complicité d’abus de confiance » dans l’affaire togolaise ; décision finale qui relève du juge d’instruction.
Le nouveau front ouvert par les ONG africaines ne repart pas de zéro : il agrège des éléments déjà connus et les relie à une demande de restitution fondée sur la loi française de 2021. En droit, la portée de la plainte dépendra d’un examen préalable du PNF, susceptible de déboucher sur une enquête.
La défense du groupe : contestation ferme et dénonciation d’amalgames
Le groupe et ses conseils rejettent les accusations. Les avocats de la défense qualifient le dossier de « juridiquement vide et factuellement infondé », soulignant qu’aucune décision définitive n’a établi que les concessions auraient été acquises illégalement. Ils rappellent qu’une CJIP n’est pas une condamnation et que l’entreprise coopère avec la justice. Sur le fond, le groupe met en avant des investissements lourds, des gains de productivité portuaire et des emplois qualifiés. En filigrane, une ligne argumentative : confondre relations d’affaires, communication institutionnelle et corruption relèverait d’un raccourci.
Du côté pénal, les pièces versées par les enquêteurs dans les volets Togo/Guinée ont toutefois intégré des éléments saisis qui décrivent, selon l’ordonnance de 2021, la promesse d’« offres », « présents » ou « avantages » prohibés au sens de la corruption d’agent public étranger.
Un empire africain cédé, mais un héritage qui perdure
Historiquement, Bolloré Africa Logistics (BAL) a agrégé en Afrique de l’Ouest et centrale un réseau de concessions portuaires et ferroviaires, s’appuyant sur l’héritage SDV/Saga/Socopao et sur des partenariats avec les autorités portuaires. En 2022, le groupe a vendu 100 % de BAL au géant MSC, pour une valeur d’entreprise de 5,7 milliards d’euros ; la nouvelle entité, Africa Global Logistics (AGL), opère aujourd’hui 17 terminaux à conteneurs et revendique 22 concessions portuaires et ferroviaires sur le continent. Cette cession n’efface pas le passé : les plaignants soutiennent que le prix de vente intégrerait des gains tirés de pratiques contestées, d’où leur stratégie de restitution. Le groupe, lui, martèle que la valorisation reflète des actifs performants et des perspectives de croissance.
Les enjeux économiques : quand la logistique façonne la souveraineté
En Afrique, 80 % du commerce international passe par la mer et la connectivité portuaire conditionne le coût d’acheminement, la compétitivité des exportations et la sécurité des chaînes d’approvisionnement. En 2021, le continent représentait environ 6,9 % des cargaisons chargées et 5 % des volumes déchargés dans le commerce maritime mondial : des parts modestes, mais appelées à croître. Dans cette équation, le contrôle des ports est un levier macroéconomique. Pour les États, la question n’est pas seulement le “qui” opère, mais “à quelles conditions” : partage de revenus, engagements d’investissements, transfert de compétences, transparence contractuelle.
Les contentieux ont un coût. En Guinée, la réattribution polémique du terminal à conteneurs de Conakry a entraîné plus d’une décennie de procédures arbitrales et judiciaires ; un concurrent a chiffré ses pertes revendiquées à plusieurs dizaines de millions d’euros, et des décisions ont, à certains stades, condamné des acteurs à des paiements avant d’être partiellement annulées par d’autres juridictions. Au-delà des montants, l’incertitude contractuelle pèse sur l’attractivité et retarde des modernisations cruciales pour les économies.
Portée judiciaire et perception internationale
Si la plainte des ONG aboutissait à des investigations sur de nouveaux faits ou à des saisies en vue d’une restitution, elle constituerait un test grandeur nature du mécanisme français de 2021 sur les “biens mal acquis” et de la coopération judiciaire avec les pays concernés. Côté image, la procédure ravive une critique récurrente : l’idée d’une “dépendance logistique” de plusieurs pays vis-à-vis d’opérateurs étrangers, perçue par certains comme un instrument d’influence. À l’inverse, d’autres gouvernements et chargeurs voient dans les concessions privées un moyen d’accélérer la mise à niveau d’infrastructures capital-intensives, à condition d’un encadrement rigoureux.
L’affaire rebat en outre les cartes d’un débat franco-africain sensible : la France peut-elle, dans le même mouvement, promouvoir la lutte anticorruption, protéger la sécurité juridique des investissements et éviter que ses groupes ne soient accusés d’abus d’influence ? La réponse passera moins par des déclarations que par la qualité des preuves et la tenue d’audiences publiques.
Conclusion
Cette plainte ne préjuge pas du droit : elle rouvre un dossier où s’entremêlent ingénierie contractuelle, communication politique et géoéconomie des ports. Trois points émergent. D’abord, la justice française a désormais des outils pour articuler poursuites et restitution au bénéfice des populations, mais leur activation exige des faits établis et des qualifications solides. Ensuite, l’histoire des concessions montre qu’un port est plus qu’un quai : c’est une rente de souveraineté qui justifie des clauses transparentes, des appels d’offres robustes et des gardes-fous sur les conflits d’intérêts. Enfin, la défense de Bolloré et l’exigence des ONG convergent paradoxalement sur un terrain commun : celui d’un examen public sur pièces. C’est là, et seulement là, que se tranchera la ligne de partage entre influence légitime et corruption.