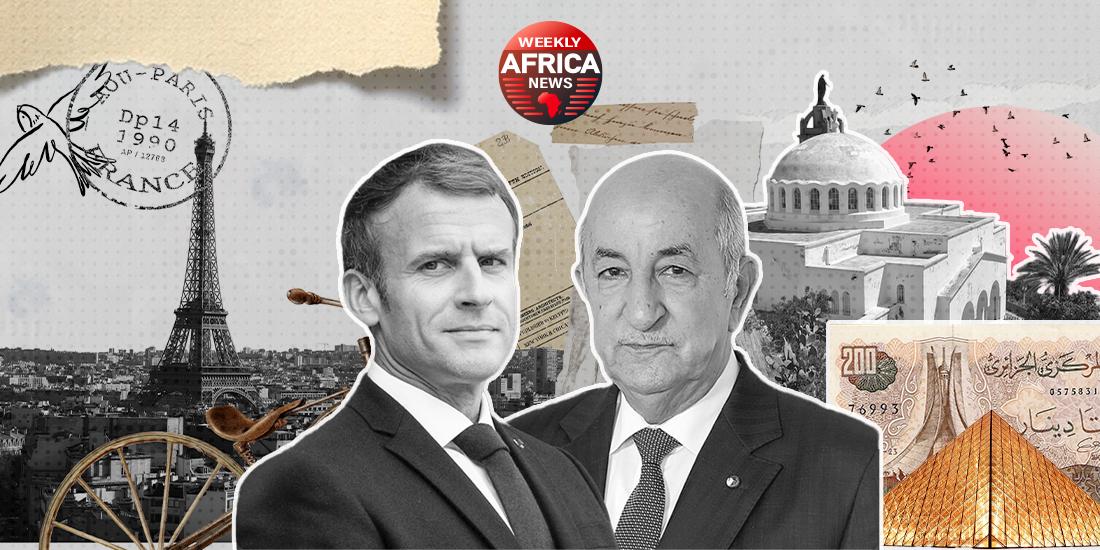Agrobusiness au Sénégal : Pourquoi les promesses de Faye et Sonko peinent à convaincre ?
Au Maroc, un dossier judiciaire met à l’épreuve les institutions, l’État de droit et l’image internationale du pays : l’« affaire Escobar du Sahara », centrée sur El Hadj Ahmed Ben Brahim, Malien d’origine et figure majeure du narcotrafic sahélo-maghrébin. Derrière le surnom, un réseau présumé tentaculaire mêlant routes transsahariennes, complicités supposées dans l’appareil public et acteurs politiques de premier plan. Le procès, ouvert en mai 2024 à Casablanca, se poursuit en 2025, et ses audiences ont déjà livré une matière factuelle rare pour appréhender les enjeux judiciaires, financiers et diplomatiques.
1) Le cœur du dossier : un réseau transnational et des accusés de premier plan
Le problème central tient en une question : un baron de la drogue déjà détenu peut-il, par ses déclarations et les éléments saisis par les enquêteurs, établir l’existence d’un système organisé ayant, pendant des années, fait circuler des tonnes de résine de cannabis, blanchi des capitaux et corrompu des relais aux frontières ? L’instruction puis le procès ont placé au premier plan deux responsables politiques d’envergure, Saïd Naciri (ex-président du conseil préfectoral de Casablanca et ex-président du Wydad AC) et Abdenbi/Abdennabi Bioui (ex-président du conseil régional de l’Oriental), poursuivis pour des faits graves : trafic international de stupéfiants, corruption, faux et usage de faux, blanchiment, entre autres. Tous contestent les charges, et la présomption d’innocence demeure. Dans cette procédure, Ben Brahim, déjà condamné au Maroc dans une affaire antérieure, est partie civile et plaignant ; ses révélations et celles de témoins alimentent l’accusation, sans la dispenser d’apporter la preuve.
2) Les faits établis et une chronologie robuste
Plusieurs éléments factuels sont aujourd’hui documentés. D’abord, le profil du principal intéressé : arrêté en 2019 à l’aéroport Mohammed-V, Ben Brahim purge une peine antérieure et a été associé par la justice marocaine à un trafic de grande ampleur. Les autorités et la presse internationale ont rappelé l’existence d’une saisie record de résine de cannabis en 2015 liée à son nom, tandis que des épisodes plus anciens le situent déjà au cœur de flux transatlantiques et sahéliens. Ensuite, l’enquête conduite par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) à partir de 2023 a donné lieu à un vaste coup de filet : une première vague d’au moins 25 mis en cause, puis une extension à 28 personnes poursuivies au fil de l’instruction. Deux commissaires divisionnaires ont été suspendus à titre conservatoire dans l’attente de l’issue du dossier ; des audiences publiques détaillent écoutes, flux financiers et transactions immobilières contestées. À la barre, Bioui a nié tout lien avec le trafic. Naciri a, lui aussi, rejeté les accusations en bloc, promettant de « réfuter » les charges. Ces dénégations publiques structurent la ligne de défense.
3) La mécanique des routes : frontière orientale, routes sahariennes et corridor ibérique
Pour comprendre l’architecture du trafic, il faut combiner le terrain marocain et le contexte euro-maghrébin. Sur le plan interne, des audiences ont décrit un modus operandi aux confins de l’Oriental, à la frontière maroco-algérienne : des « points » de passage identifiés, des gardes-fous techniques (caméras) contournés, une rémunération tarifée par « ballot » pour des agents complices, et des « petites mains » locales mobilisées de nuit. Le volume cumulé évoqué par l’accusation, plus de 200 tonnes acheminées sur la période, donne l’échelle. Sur le plan régional, les récits concordent : une partie du flux transite par le Sahel vers l’Algérie et la Libye, tandis qu’une autre s’achemine par voie maritime vers les côtes marocaines, avant de rejoindre l’Europe. Au débouché, l’Espagne reste, de longue date, le premier corridor d’entrée de la résine marocaine sur le marché européen. Ce maillage géographique, ancien et adaptable, explique la résilience des filières et la difficulté à les démanteler intégralement.
4) Les acteurs, leurs intérêts et leurs stratégies
Quatre familles d’acteurs se dessinent.
Le noyau criminel : autour de Ben Brahim, la justice décrit un réseau flexible, capable de combiner logistique saharienne, relais locaux et circuits financiers opaques. L’intérêt : contrôler une chaîne de valeur de la source aux points de sortie.
Les relais frontaliers et sécuritaires : des militaires en poste à la frontière sont évoqués dans les audiences, avec des allégations de détournement des dispositifs de surveillance contre rétribution. Deux officiers de police ont été suspendus durant la procédure. Si ces soupçons se confirment, ils révèleraient des brèches exploitables par les trafiquants.
Les responsables politiques : la mise en cause de figures du Parti authenticité et modernité (PAM) a déclenché des réactions administratives (procédure de remplacement à la tête des collectivités). Leurs intérêts et stratégies de défense reposent sur la contestation de la crédibilité des plaignants, la réfutation des flux financiers incriminés et la dénonciation de « procès d’intention ».
Les institutions judiciaires et douanières : le parquet et la chambre criminelle mènent un procès fleuve, tandis que l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) s’est constituée partie civile, réclamant des sommes colossales au titre des pénalités, signe que l’État cherche à frapper au portefeuille autant qu’au le pénal.
5) Enjeux pour les citoyens, les institutions et la scène internationale
Pour les citoyens, l’affaire cristallise deux exigences : l’égalité de tous devant la loi et l’assainissement des zones frontalières où l’économie informelle prospère faute d’alternatives. La crédibilité du procès se mesurera à la qualité de la preuve (écoutes, traçabilité bancaire, expertises) et à la cohérence des décisions.
Pour les institutions, l’enjeu est institutionnel : que révèlent ces soupçons sur la robustesse des contrôles internes (police, armée, douanes), sur la gouvernance locale (attributions de marchés, patrimoine), et sur la capacité à suivre des flux transfrontaliers ? Les débats sur le rôle des partis, y compris la gestion disciplinaire de leurs cadres, sont un test de maturité politique.
Pour l’international, le dossier s’inscrit dans une double dynamique contradictoire : d’un côté, le Maroc a légalisé la culture du cannabis à des fins médicales et industrielles et cherche à structurer une filière légale dans le Rif ; de l’autre, la persistance d’un marché noir transnational, dopé par la demande européenne, entretient une perception ambivalente. L’attention de partenaires européens, préoccupés par les flux de résine via l’Espagne, reste élevée ; la coopération policière et judiciaire euro-maghrébine est ici centrale.
6) Justice, argent et diplomatie : une triple bataille
Judiciaire : la charge de la preuve incombe à l’accusation, et la procédure a déjà montré ses exigences : auditions à rallonge, confrontations, exploitation d’écoutes, analyse de documents bancaires, expertise de transactions immobilières. Les délais, nombreux renvois et « procès dans le procès » (diffamation alléguée, témoins contestés) illustrent un contentieux volumineux, mais inévitable si l’on veut éviter toute décision fragile en appel.
Financière : les flux mis en cause feront l’objet d’un tri juridique sévère : distinguer les ressources personnelles légitimes des capitaux d’origine criminelle, établir des chaînes de valeur, confondre les éventuels porteurs « prête-noms ». La demande de l’ADII (plusieurs milliards de dirhams) signale une volonté de dissuasion par le coût.
Diplomatique : dans un contexte de relations tendues avec Alger, l’« Affaire Escobar du Sahara » nourrit un récit antagoniste : le Maroc se présente comme État de droit qui assainit ; l’Algérie y voit un élément rhétorique pour dénoncer « l’inondation » de son territoire. La vérité judiciaire, lorsqu’elle sera dite, pèsera au-delà du prétoire : sur la coopération frontalière, la confiance des partenaires européens, et l’attractivité d’une filière légale naissante.
Conclusion
À ce stade, le procès n’a pas tranché. Il a toutefois mis au jour une matière rare sur les modes opératoires des trafics, les zones de porosité institutionnelle et l’entrelacs entre argent, pouvoir local et économie criminelle. L’enjeu, pour la justice marocaine, est de rendre une décision qui soit juridiquement solide, lisible et exemplaire ; pour l’État, de transformer les enseignements en politiques publiques : contrôle interne renforcé, équilibres économiques dans les régions frontalières, traçabilité financière, coopération internationale accrue. À défaut, l’affaire continuerait d’alimenter un doute coûteux : celui d’un pays qui modernise sa filière légale tout en peinant à tarir un marché noir transnational.