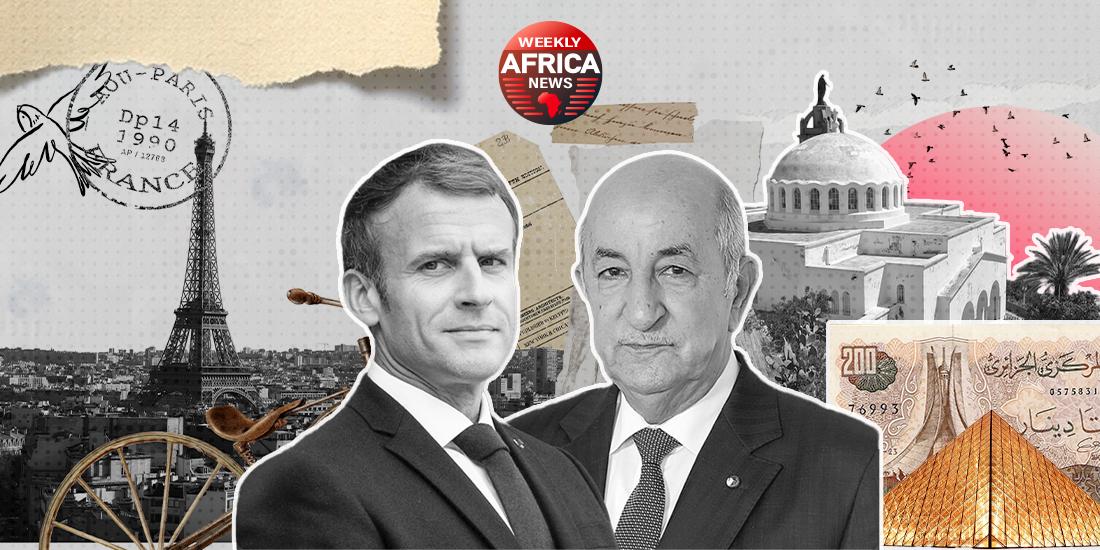Agrobusiness au Sénégal : Pourquoi les promesses de Faye et Sonko peinent à convaincre ?
Après deux coups d’État successifs en 2020 et 2021, le Mali est engagé dans une transition politique incertaine. Le colonel Assimi Goïta, auteur des putschs et président de la transition, a annoncé son intention de quitter le pouvoir en 2025 au profit d’autorités civiles élues. Cette perspective marque un tournant potentiellement historique pour le pays, qui n’a plus connu de scrutin présidentiel depuis 2018. Les enjeux sont considérables : il s’agit de restaurer un ordre constitutionnel crédible après des années d’instabilité, tout en affrontant une situation sécuritaire périlleuse et en naviguant entre des influences géopolitiques contradictoires. Le sort de la transition malienne dépasse les frontières du pays – il intéresse toute l’Afrique de l’Ouest, ébranlée par une vague de putschs, et capte l’attention de partenaires internationaux tels que la CEDEAO, la France ou la Russie. L’annonce du départ de Goïta en 2025 soulève ainsi autant d’espoirs de normalisation démocratique que d’incertitudes sur la capacité réelle de la junte à tenir ses promesses.
Sur le plan interne, la transition malienne est dominée par les militaires, avec Assimi Goïta et son cercle d’officiers occupant la quasi-totalité des postes clés. Le gouvernement de transition, initialement conçu pour être inclusif, s’est progressivement militarisé, marginalisant les acteurs civils. En novembre 2024, Goïta a même limogé son Premier ministre civil, Choguel Kokalla Maïga, à la suite de tensions croissantes – ce dernier avait publiquement critiqué les nombreux reports des élections et la gestion de la transition, une prise de position rare qui lui a coûté son poste. Depuis, tous les organes de la transition sont contrôlés par des figures de l’armée, renforçant l’idée que les colonels entendent garder la main sur le processus politique.
Cette concentration du pouvoir a suscité des réactions contrastées au sein de la société malienne. D’un côté, une partie de la population, lassée des anciennes élites civiles jugées corrompues ou inefficaces, a soutenu le discours de la junte promettant un « changement » et la restauration de la souveraineté nationale. Des mouvements et associations se sont mobilisés pour appuyer les autorités de transition, relayant un narratif patriotique qui dénonce les ingérences extérieures et justifie la poigne des militaires. De l’autre côté, l’enthousiasme du départ a laissé place chez beaucoup à l’inquiétude, au fur et à mesure que la transition s’éternise sans calendrier électoral fiable. La classe politique d’opposition et de nombreuses organisations de la société civile, tenues à l’écart des centres de décision, redoutent une confiscation durable du pouvoir par l’armée. « Le seul but du dialogue était de prolonger la transition », a déploré fin 2023 le dirigeant d’un parti d’opposition, fustigeant les consultations nationales orchestrées par le régime sans véritable inclusion de la pluralité malienne. Le climat intérieur est d’autant plus tendu que l’espace démocratique s’est rétréci : les voix dissidentes font face à des pressions, certaines figures critiques ayant été arrêtées ou intimidées, et les médias indépendants subissent censure et suspension s’ils déplaisent au discours officiel. Par exemple, les autorités de Bamako ont coupé en 2022 la diffusion de RFI et de France 24, deux médias internationaux, leur reprochant une couverture jugée hostile. Cette atmosphère délétère laisse planer un doute sur la volonté réelle des militaires de céder le pouvoir à brève échéance, malgré leurs engagements publics.
Parallèlement à la crise politique, le Mali continue d’être confronté à une grave insécurité. Depuis 2012, le pays est en proie aux insurrections jihadistes liées à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et à l’organisation État islamique, ainsi qu’à des rébellions armées dans le Nord. En arrivant aux commandes, Assimi Goïta et les siens ont fait de la restauration de la sécurité une priorité affichée, justifiant en partie leur prise de pouvoir par l’inefficacité du régime précédent à juguler le terrorisme. En 2022, la junte a exigé et obtenu le retrait de l’opération militaire française Barkhane et de la force Takuba, marquant la fin de la présence antiterroriste française au Mali. En juin 2023, elle a aussi poussé vers la sortie la Mission des Nations unies (MINUSMA), accusant celle-ci d’échec et de partialité, ce qui a abouti à la fermeture définitive de la mission onusienne fin 2023. Ces départs ont eu pour effet de redéfinir radicalement le paysage sécuritaire : l’armée malienne se retrouve en première ligne, appuyée par de nouveaux partenaires, notamment le groupe paramilitaire russe Wagner, présent sur le terrain depuis fin 2021.
La coopération avec Wagner et l’acquisition d’équipements militaires russes (avions de combat, hélicoptères, drones) ont permis aux Forces armées maliennes (FAMa) de lancer des offensives d’envergure contre les groupes extrémistes. Les autorités de transition se félicitent de certaines victoires tactiques : dans son message du nouvel an 2025, le Président Goïta a affirmé que des opérations spéciales dans la région de Kidal avaient neutralisé des chefs terroristes, illustrant selon lui un tournant décisif dans la lutte contre les jihadistes. De fait, l’armée malienne a récemment reconquis des positions dans le nord du pays, profitant du vide laissé par le départ de la MINUSMA. En décembre 2023, elle a annoncé avoir repris le contrôle de Kidal, ancien bastion de la rébellion touarègue, grâce à des frappes aériennes et l’appui de conseillers militaires étrangers. Cependant, ces avancées restent fragiles et controversées : des sources locales et humanitaires ont fait état de victimes civiles lors des bombardements à Kidal et de déplacements massifs de populations fuyant les combats. Sur le terrain, les groupes liés à Al-Qaïda (la branche JNIM) et à l’EI continuent de sévir. Ils ont même intensifié leurs attaques dans de nombreuses zones du centre et du nord ces derniers mois, profitant parfois de l’absence de forces internationales pour étendre leur influence. La situation reste donc extrêmement volatile : si l’armée malienne affiche un moral regonflé et une meilleure capacité offensive grâce à ses nouveaux partenariats, les experts relèvent que le nombre d’attaques contre les civils n’a pas diminué de manière significative. Le défi de sécuriser tout le territoire demeure colossal, ce qui pose la question de la faisabilité d’élections libres sur l’ensemble du pays.
Autre facteur d’insécurité, la recrudescence des tensions avec les ex-rebelles du Nord ajoute une couche de complexité. L’accord de paix d’Alger signé en 2015 entre Bamako et la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA, coalition de groupes armés à dominante touarègue) s’est effondré en 2023. Considérant que les ex-rebelles avaient rompu la trêve et que la médiation stagnait, la junte a annoncé en janvier 2024 la fin pure et simple de cet accord. Depuis mi-2023, des affrontements armés ont repris entre l’armée malienne (soutenue par des combattants de Wagner) et les combattants de la CMA dans le nord du Mali. La rupture du processus de paix ravive le spectre d’une nouvelle rébellion généralisée dans l’Azawad et menace la stabilité à long terme. Pour le moment, le gouvernement de transition affirme vouloir rétablir l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire par la force et promet de développer parallèlement les zones reconquises. Néanmoins, l’absence de règlement politique avec les communautés du Nord pourrait alimenter un cycle de violence durable. La lutte contre le terrorisme et la préservation de l’unité nationale seront donc des dossiers brûlants pour tout successeur de Goïta en 2025 : le prochain gouvernement héritera d’un pays toujours en guerre contre des insurrections multiples, avec une armée mieux équipée mais confrontée à des foyers de crise disséminés.
La transition malienne s’inscrit dans un contexte géopolitique où le Mali a radicalement redéfini ses partenariats. Sous Assimi Goïta, Bamako a opéré un virage stratégique vers la Russie et d’autres puissances non-occidentales, concomitant à une prise de distance spectaculaire avec la France, ancien allié traditionnel. Les raisons invoquées par les autorités maliennes sont multiples. D’une part, une profonde frustration envers l’aide française jugée inefficace contre les terroristes, voire soupçonnée de visées occultes. D’autre part, la volonté affichée de restaurer la souveraineté nationale et de ne plus dépendre d’« alliances déséquilibrées ». Dès début 2022, la junte a dénoncé les accords de défense avec Paris, accusant l’armée française de violations flagrantes de la souveraineté malienne. Le départ précipité des troupes françaises en août 2022 a été applaudi par certains au Mali comme une « libération », et accompagne un discours officiel de plus en plus virulent à l’égard de l’ancienne puissance coloniale. La rhétorique souverainiste du régime Goïta trouve un écho chez une partie de la jeunesse urbaine, sensible aux messages panafricanistes et aux théories dénonçant un néo-colonialisme occidental.
En contrepartie, Bamako s’est tourné vers Moscou pour combler le vide sécuritaire et diversifier ses partenariats économiques. La Russie n’a pas tardé à saisir l’occasion de renforcer son influence au Sahel. Des accords de coopération militaire et économique ont été signés, et le Mali a reçu plusieurs livraisons d’armes russes ces dernières années. En février 2023, la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à Bamako a symbolisé ce rapprochement spectaculaire. « Nous n’avons pas à nous justifier de travailler avec la Russie », a déclaré à cette occasion le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, balayant les préoccupations occidentales. Lavrov a de son côté promis de continuer à aider le Mali à renforcer ses capacités militaires, louant les succès obtenus grâce aux équipements fournis par Moscou. Sur le plan diplomatique, le Mali reçoit un soutien appuyé de la Russie dans les instances internationales : Moscou a par exemple bloqué à l’ONU des résolutions initiées par la France visant à maintenir un régime de sanctions contre le Mali, se posant en protecteur du régime de transition face aux pressions extérieures.
La prise de distance avec les partenaires occidentaux ne se limite pas à la France. Les relations avec l’Union européenne et les États-Unis se sont également dégradées. L’UE a suspendu ses missions de formation de l’armée malienne (EUTM Mali) en raison de la présence de mercenaires russes et des violations des droits humains documentées. Plusieurs programmes d’aide au développement ont été ralentis ou réorientés, bien que l’aide humanitaire d’urgence se poursuive compte tenu des besoins de la population. De son côté, Washington a exprimé à maintes reprises sa préoccupation concernant le partenariat avec Wagner et le retard pris dans la transition démocratique – des inquiétudes allant jusqu’à brandir la menace de sanctions ciblées contre les dirigeants de la junte. À l’ONU, le retrait de la MINUSMA a acté l’isolement croissant de Bamako vis-à-vis de la communauté internationale traditionnelle. Parallèlement, le Mali cherche de nouveaux relais : au-delà de la Russie, les autorités de transition ont affiché leur volonté de coopérer davantage avec la Chine (notamment dans les infrastructures et les mines), la Turquie ou encore les voisins du Maghreb. Cette redéfinition des alliances s’inscrit dans un mouvement plus large de rejet de l’ingérence perçue des puissances occidentales en Afrique de l’Ouest, mouvement dont le Mali de Goïta se veut l’un des fers de lance.
Sur le plan régional, Bamako a noué des liens étroits avec d’autres pays dirigés par des juntes militaires partageant son ressentiment envers la pression internationale. Le Mali s’est rapproché de la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya (coup d’État en 2021) et surtout du Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré (putsch en 2022). Ces trois régimes de transition se soutiennent mutuellement face aux sanctions et critiques. En 2023, Bamako, Ouagadougou et Conakry ont multiplié les consultations et même conclu un partenariat de coopération sécuritaire et de défense mutuelle. Lorsque la CEDEAO a envisagé une intervention militaire contre les putschistes au Niger à l’été 2023, le Mali et le Burkina Faso ont immédiatement averti qu’ils considéreraient une telle action comme “une déclaration de guerre” contre eux aussi, affichant une solidarité sans faille avec Niamey. Ce front commun des juntes sahéliennes a conduit à la création en septembre 2023 de l’Alliance des États du Sahel, un nouveau bloc de coopération entre Mali, Burkina et Niger, visant à coordonner leurs politiques de sécurité et d’économie en marge des structures régionales classiques. Cette évolution transforme la donne géopolitique en Afrique de l’Ouest : le Mali de Goïta s’inscrit désormais dans un axe régional contestataire de l’ordre ancien, opposé aux orientations pro-occidentales de pays comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire ou le Nigeria. La conséquence en est un bras de fer diplomatique à l’échelle sous-régionale, le Mali n’hésitant plus à claquer la porte des instances jugées hostiles. Bamako a ainsi confirmé son retrait effectif de la CEDEAO à compter de janvier 2025, en même temps que ses alliés du Burkina et du Niger, se coupant du principal organe d’intégration ouest-africain. De même, les autorités maliennes ont officialisé en mars 2025 leur départ de l’Organisation internationale de la Francophonie, symbolisant la rupture avec la sphère d’influence francophone. Ce repositionnement diplomatique audacieux satisfait l’opinion nationaliste malienne qui voit là une affirmation d’indépendance, mais il comporte le risque d’isoler davantage un Mali enclavé et économiquement vulnérable.
La perspective d’une sortie de crise politique par les urnes reste floue, malgré l’engagement répété de la junte à rétablir un gouvernement civil. Initialement, après le putsch d’août 2020, les militaires s’étaient engagés devant la CEDEAO à une transition de 18 mois aboutissant à des élections en février 2022. Cet échéancier a volé en éclats avec le second coup d’État de mai 2021, par lequel Assimi Goïta s’est emparé officiellement de la présidence de la transition. Sous pression régionale, un nouveau délai a été négocié : la junte a proposé un chronogramme menant à une élection présidentielle en février 2024, compromis que la CEDEAO a fini par accepter. Dans cette optique, les autorités de transition ont entrepris certaines réformes politiques : organisation d’assises nationales refondatrices, rédaction d’une nouvelle constitution, et élaboration d’une loi électorale. En juin 2023, un référendum constitutionnel a été tenu – le premier scrutin national depuis le coup d’État. Officiellement, le texte a été approuvé à une écrasante majorité de 97% des votants, et la junte a salué cette nouvelle Constitution comme le prélude au retour à l’ordre civil début 2024. Le taux de participation n’a toutefois atteint qu’environ 39%, l’opposition ayant appelé au boycott et de larges zones du nord étant exclues du vote du fait de l’insécurité. Le nouveau texte fondamental renforce les pouvoirs du président de la République, ce qui suscite la controverse – d’aucuns y voient une manière pour les militaires de verrouiller l’architecture institutionnelle en leur faveur avant de passer la main. En particulier, la Constitution révisée permet aux membres de la junte de se présenter aux élections ou d’occuper des postes dans le prochain gouvernement, levant ainsi l’obstacle qui empêchait théoriquement Assimi Goïta de briguer la magistrature suprême en tant que chef de la transition.
Malgré ces étapes formelles, l’agenda électoral a connu de nouveaux retards. À l’approche de l’échéance de février 2024, le gouvernement a invoqué des “raisons techniques” – notamment des retards dans l’établissement des listes électorales biométriques et dans l’organisation du vote des Maliens de la diaspora – pour reporter le scrutin sine die. L’annonce, faite en septembre 2023, a entériné le fait qu’aucune présidentielle n’aurait lieu dans le délai convenu. Depuis lors, aucune date précise n’a été fixée pour les élections, plongeant le processus de transition dans l’incertitude. Officieusement, un allongement de la transition de plusieurs mois ou années est envisagé. En mai 2024, les “Assises du refondation” organisées par le régime ont même recommandé de prolonger la transition jusqu’à cinq ans au total, ce qui repousserait l’échéance électorale à 2026 voire 2027. Ces orientations ont été fermement rejetées par une grande partie de la classe politique malienne. Les partis d’opposition et de nombreux leaders de la société civile exigent au contraire un calendrier précis et rapproché pour rendre le pouvoir aux civils. Ils estiment que la crédibilité de la transition en dépend : à leurs yeux, plus la transition s’éternise, plus le risque d’un enracinement autoritaire augmente.
Le paysage politique malien se prépare toutefois, bon gré mal gré, à d’éventuelles élections en 2025. Les partis traditionnels – du moins ceux qui ne sont pas interdits d’activité – commencent à se repositionner. Certains visages connus de la scène malienne, tels d’anciens ministres ou opposants, affûtent leurs arguments en espérant rallier une population éprouvée par la crise. Néanmoins, la compétition électorale ne se déroulera pas à armes égales. Le régime militaire, toujours en place, contrôle les organes chargés d’organiser le scrutin et maintient un climat dissuasif pour toute critique ouverte. La liberté de la presse demeure restreinte, et les réunions politiques fortement encadrées. Dans ces conditions, la transparence du futur scrutin sera un enjeu majeur suivi de près par les observateurs étrangers. Les organisations maliennes de défense des droits et des élections libres appellent à la mise en place de garanties – comme une commission électorale réellement indépendante, la présence d’observateurs internationaux et la liberté de campagne – pour éviter que la présidentielle à venir ne soit qu’une formalité consacrant le pouvoir en place. Reste aussi l’épineuse question de la participation d’Assimi Goïta lui-même : officiellement, rien ne l’empêche désormais de se présenter comme candidat en 2025. S’il renonçait à briguer la présidence, cela ouvrirait le champ à une transition plus apaisée, mais la tentation de légitimer son pouvoir par les urnes pourrait être forte. Nombre d’observateurs craignent qu’une candidature de Goïta ou d’un autre haut gradé ne biaise le jeu démocratique et ne conduise à un résultat contesté, ce qui compromettrait la stabilisation recherchée.
La trajectoire du Mali sous Goïta a mis à rude épreuve les mécanismes régionaux de gestion des crises politiques. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en particulier, s’est retrouvée confrontée à une série de dilemmes. Réunie en sommet extraordinaire peu après chaque coup d’État, la CEDEAO a condamné fermement ces ruptures de l’ordre constitutionnel et suspendu le Mali de ses instances dès 2020. Pour contraindre la junte à restituer le pouvoir, l’organisation a usé de l’arme des sanctions économiques. En janvier 2022, face à la velléité des militaires de prolonger la transition au-delà du délai initialement promis, la CEDEAO a imposé un embargo commercial et financier total sur le Mali, fermant les frontières de ses pays membres et gelant les avoirs maliens dans la région. Ces mesures sévères ont asphyxié pendant plusieurs mois l’économie malienne, qui dépend largement des échanges régionaux, provoquant une inflation et des pénuries dans certains secteurs. Sous cette pression, Assimi Goïta a finalement présenté un calendrier de transition plus acceptable (les fameux 24 mois devant mener à mars 2024), ce qui a amené la CEDEAO à lever progressivement les sanctions mi-2022. Néanmoins, les retards accumulés depuis ont recréé des frictions. Les médiateurs ouest-africains – menés par l’ancien Président nigérian Goodluck Jonathan – ont multiplié les visites à Bamako pour tenter de garder le dialogue ouvert et obtenir une date ferme d’élections. Chaque sommet de la CEDEAO, jusqu’en fin 2023, a réitéré l’exigence d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel au Mali.
L’équation s’est encore compliquée avec la crise nigérienne de 2023 : l’attention de la CEDEAO s’est partagée entre plusieurs fronts, et le Mali a choisi de défier ouvertement l’organisation régionale en soutenant le coup d’État chez son voisin. En riposte à cette solidarité entre putschistes, la CEDEAO a menacé d’exclure purement et simplement le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont anticipé en annonçant eux-mêmes leur retrait. À la fin 2024, l’organisation ouest-africaine a acté la future sortie de ces trois membres frondeurs d’ici janvier 2025, tout en laissant une porte ouverte à la réintégration s’ils revenaient à l’ordre constitutionnel. Ainsi, paradoxalement, l’année 2025 pourrait voir le Mali organiser des élections sous l’égide de sa transition, mais en dehors du cadre de la CEDEAO, une première dans l’histoire récente de la région. L’Union africaine, qui avait emboîté le pas de la CEDEAO en suspendant le Mali, se retrouve également dans une position délicate : attachée au principe du rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement, elle a pourtant peu de leviers pour infléchir le cours malien face à la défiance de Bamako.
D’autres acteurs internationaux jouent un rôle non négligeable en coulisse. Les Nations unies, par le biais notamment du Conseil de sécurité, ont suivi de près l’évolution de la transition malienne. Cependant, les divisions entre grandes puissances – France d’un côté, Russie de l’autre – ont paralysé toute action coercitive. La MINUSMA, autrefois bras opérationnel de l’ONU au Mali, n’est plus là pour soutenir le processus électoral comme elle l’avait fait lors des scrutins passés. L’ONU et ses agences maintiennent un engagement humanitaire et appellent régulièrement au respect des droits de l’homme durant la transition, mais leur influence politique est limitée. Du côté des partenaires bilatéraux, la Francereste vocalement critique vis-à-vis de la junte malienne. Paris, qui a replié toutes ses forces militaires du pays, insiste sur la nécessité d’élections crédibles et inclusives. Les officiels français dénoncent la présence de Wagner et redoutent que le Mali ne devienne un sanctuaire terroriste du fait de la rupture de coopération. Toutefois, la France n’a plus les moyens d’une intervention directe et mise surtout sur l’action collective de l’UE et de la CEDEAO pour favoriser un retour à la démocratie. A contrario, la Russie soutient diplomatiquement le gouvernement de transition, arguant du principe de non-ingérence. Dans les forums internationaux, les représentants russes relativisent les critiques sur le Mali et soulignent les progrès sécuritaires accomplis. Cette divergence de vues entre partenaires extérieurs place le Mali au cœur d’enjeux géopolitiques qui le dépassent : il est devenu un terrain d’expression de la rivalité d’influence entre puissances, ce qui complique le rôle des médiateurs neutres. La Communauté internationale dans son ensemble s’accorde néanmoins sur un point : la nécessité que la transition malienne aboutisse à un pouvoir civil légitime, seule issue susceptible de stabiliser durablement le pays et de permettre la reprise pleine des coopérations. Reste à voir si cet objectif pourra être atteint dans les délais annoncés et dans des conditions satisfaisantes.
À l’aube de 2025, le Mali se trouve à la croisée des chemins. Le départ promis d’Assimi Goïta cristallise de multiples interrogations quant à l’avenir politique du pays. La première incertitude porte sur le calendrier électoral effectif : l’organisation d’une élection présidentielle crédible durant l’année 2025 est-elle réalisable ? Si le gouvernement de transition parvient à fixer une date et à mener le scrutin, ce sera un exploit logistique et sécuritaire, compte tenu des défis persistants. Il faudra garantir la sécurité du vote dans un contexte de violences, acheminer le matériel électoral dans les zones reculées ou instables, et convaincre l’ensemble des acteurs de participer au processus. Le risque d’un faible taux de participation ou d’une contestation des résultats est réel, surtout si d’importantes portions du territoire – notamment dans le Nord – ne peuvent voter normalement. Un scrutin partiel ou entaché d’irrégularités pourrait déboucher sur une légitimité fragile du nouveau pouvoir civil, voire sur des troubles post-électoraux.
La deuxième grande inconnue concerne le rôle futur des militaires. Si Assimi Goïta se retire comme il l’a annoncé, quelle sera la place de l’armée dans le Mali de l’après-transition ? Deux scénarios sont envisagés par les analystes. Dans le premier, la junte accepte de rentrer dans le rang, les officiers regagnant les casernes et respectant le choix des urnes. Cette hypothèse optimiste permettrait au nouveau président civil de gouverner sans tutelle apparente, même si l’armée, forte de son prestige acquis pendant la transition, conserverait un poids politique implicite. Le second scénario, plus pessimiste, verrait les militaires conserver une influence de l’ombre sur le pouvoir, voire orchestrer l’accession d’un des leurs à la présidence par le biais des élections. Assimi Goïta lui-même n’a pas fait connaître ses intentions électorales. S’il décidait d’être candidat en 2025, il partirait avec l’avantage d’un appareil d’État acquis à sa cause et pourrait l’emporter, prolongeant ainsi son règne sous une autre forme. Cela poserait la question de la sincérité du processus démocratique. À l’inverse, s’il honore la promesse implicite de ne pas se présenter, la transition malienne pourrait gagner en crédibilité aux yeux de la population et des partenaires étrangers – à condition que l’élection voie émerger un leader civil compétent et rassembleur.
Enfin, l’après-2025 soulève des défis de gouvernance considérables. Le prochain pouvoir issu des urnes devra s’atteler à réconcilier un pays fragmenté. La nouvelle administration aura fort à faire pour restaurer la confiance entre l’État, les partis politiques, les groupes armés du Nord et la société civile. Elle devra relancer une économie affaiblie par des années de sanctions, de dépenses sécuritaires et de gestion chaotique, tout en obtenant la levée des mesures de suspension internationales. Sur le plan diplomatique, un Mali à nouveau dirigé par des civils aura l’opportunité de renouer pleinement avec ses voisins et de réintégrer la CEDEAO – si tant est que les relations n’aient pas été irrémédiablement altérées. Une normalisation avec les partenaires occidentaux serait également envisageable, sans nécessairement renier les nouvelles coopérations tissées avec la Russie ou d’autres. Le défi sera d’adopter une politique étrangère équilibrée, évitant les excès d’alignement exclusif, pour tirer parti de tous les soutiens possibles à la stabilisation et au développement du Mali.
En somme, l’échéance de 2025 au Mali apparaît à la fois comme un horizon d’espoir et un saut dans l’inconnu. L’annonce du départ d’Assimi Goïta, si elle se concrétise, pourrait ouvrir une nouvelle page après la domination militaire entamée en 2020. Du point de vue malien, la priorité est que cette transition débouche sur un gouvernement légitime capable de répondre aux aspirations de changement qui avaient initialement salué la chute de l’ancien régime. La réussite n’est pas garantie : elle dépendra de la capacité des acteurs nationaux à organiser des élections crédibles et à accepter leur verdict, ainsi que du soutien constructif – ou au minimum de la non-ingérence malveillante – des puissances régionales et internationales. Alors que l’Afrique de l’Ouest retient son souffle face à la prolifération des transitions militaires, le cas du Mali servira de test majeur. Une passation de pouvoir pacifique à Bamako en 2025 enverrait un signal positif de résilience démocratique. À l’inverse, un enlisement ou une manipulation de plus serait de mauvais augure pour la stabilité de la région. Plus que jamais, l’attention restera focalisée sur le Mali tout au long de l’année à venir, dans l’attente de voir si les promesses de la transition seront tenues et si le pays parviendra à sortir de ce cycle tumultueux par le haut.