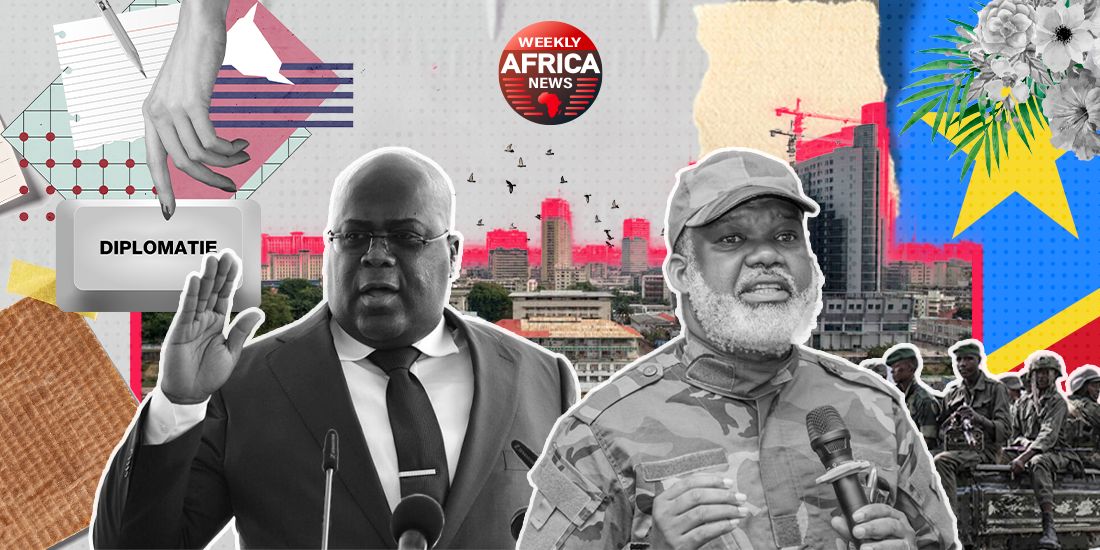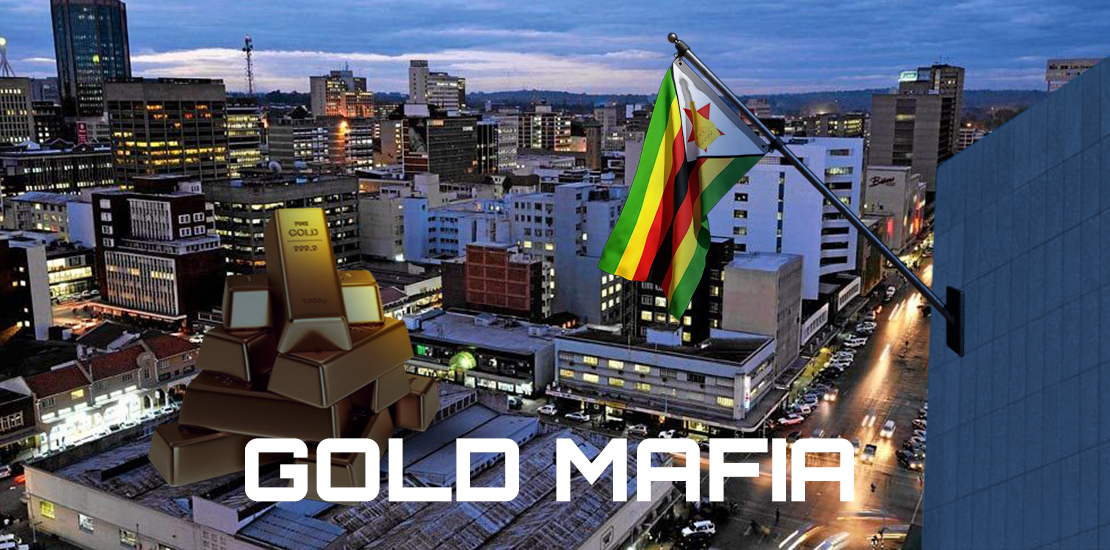Agrobusiness au Sénégal : Pourquoi les promesses de Faye et Sonko peinent à convaincre ?
La crise du M23 constitue un défi diplomatique majeur pour Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo (RDC), qui doit naviguer habilement face à Paul Kagamé, chef d’État rwandais dont l’influence sur la scène internationale reste significative. Depuis fin 2021, l’Est congolais est secoué par la résurgence du Mouvement du 23 mars (M23), une rébellion initialement vaincue en 2013 mais revenue en force en prenant le contrôle de vastes territoires dans les provinces stratégiques du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, jusqu’à menacer directement les capitales provinciales Goma et Bukavu. Cette escalade a provoqué un drame humanitaire majeur et accentué le risque d’un conflit à dimension régionale.
Face à cette crise sécuritaire et humanitaire, Félix Tshisekedi a dû engager une lutte diplomatique complexe pour obtenir un soutien international. La tâche n’était pas aisée : son voisin et rival Paul Kagamé, longtemps présenté comme un modèle de stabilité et de réussite économique, bénéficiait historiquement d’une relative immunité diplomatique liée à la culpabilité mondiale concernant le génocide rwandais de 1994. De plus, Kagamé a su habilement se positionner en partenaire clé de grandes puissances occidentales, évitant généralement les critiques ouvertes malgré les accusations récurrentes d’ingérence militaire et économique en RDC.
Toutefois, les récents développements sur le terrain ont changé la donne diplomatique. Lorsque le M23 s’est emparé successivement des grandes villes de Goma et Bukavu, l’ampleur de la menace est devenue évidente. Cette avancée militaire rebelle, associée à l’accumulation de preuves tangibles de l’implication directe des troupes rwandaises, a suscité une profonde inquiétude internationale. La crainte d’une contagion régionale, faisant planer le spectre des conflits dévastateurs des années 1990 et 2000 dans la région des Grands Lacs, a obligé les acteurs internationaux à adopter une position plus claire et ferme.
La réponse diplomatique de Kinshasa a été rapide et stratégique. Félix Tshisekedi, épaulé par sa diplomatie active, a su utiliser les mécanismes existants comme les processus de médiation de Nairobi et de Luanda. Initialement timides, ces médiations se sont progressivement durcies face à l’évidence croissante du soutien militaire extérieur au M23. La diplomatie congolaise a su capitaliser sur l’émotion suscitée par la crise humanitaire majeure, plaçant ses partenaires devant leurs responsabilités.
Les efforts de la RDC ont porté leurs fruits sur le plan continental africain. L’Union africaine (UA) a condamné explicitement les attaques du M23 et demandé fermement le retrait de toutes les forces étrangères du territoire congolais, ciblant implicitement Kigali. Par ailleurs, Kinshasa a pu s’appuyer sur la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), malgré des résultats mitigés de sa force régionale déployée dans les Kivus. Face à cette efficacité relative, Tshisekedi a aussi obtenu le soutien de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), qui a pris une position particulièrement dure contre le Rwanda. L’Afrique du Sud, acteur influent de la région, a directement mis en garde Kigali contre toute nouvelle action militaire hostile.
Au niveau international, cette évolution diplomatique s’est accélérée avec la prise de positions inédites de puissances occidentales clés. Le Conseil de sécurité des Nations unies, traditionnellement prudent dans ses déclarations concernant Kigali, a adopté à l’unanimité une résolution sans précédent. Ce texte condamne ouvertement l’offensive du M23 et exige, pour la première fois explicitement, le retrait immédiat des forces rwandaises du territoire congolais. Cette résolution représente un tournant majeur, signe que même les alliés traditionnels du Rwanda ont revu leurs positions face à la gravité du risque de conflit régional.
Cette dynamique diplomatique s’est accompagnée de mesures concrètes prises par plusieurs pays influents. Les États-Unis ont appliqué des sanctions ciblées contre des personnalités proches de Kagamé, perçues comme architectes du soutien au M23. L’Union européenne, quant à elle, a imposé des restrictions financières et économiques sévères à Kigali, menaçant notamment son accès au marché stratégique européen pour certains minéraux précieux issus du trafic illicite congolais. La France, historiquement proche de la RDC, a adopté un ton particulièrement ferme, réclamant sans ambiguïté la fin du soutien militaire rwandais à la rébellion.
Ce changement diplomatique marque une victoire importante pour Félix Tshisekedi. Jamais auparavant le Rwanda n’avait été aussi clairement désigné comme responsable d’une crise en RDC, et jamais un tel consensus international n’avait été atteint en faveur du Congo. Cette victoire diplomatique pourrait marquer un tournant dans les relations régionales et redéfinir durablement le rapport de force entre Kinshasa et Kigali.
Cependant, des défis importants demeurent. Le M23, bien qu’affaibli diplomatiquement, demeure actif sur le terrain et capable de mener des opérations militaires significatives. Le risque d’une escalade militaire généralisée est réel tant que des forces étrangères restent présentes sur le territoire congolais. De plus, la coalition internationale qui soutient désormais la RDC pourrait être tentée d’imposer une solution militaire rapide, ce qui accentuerait les risques de conflit régional majeur, rappelant les guerres dévastatrices du passé récent.
Ainsi, malgré l’avancée diplomatique majeure obtenue par Félix Tshisekedi, le défi reste entier. La clé réside désormais dans la capacité de Kinshasa à transformer ce soutien international en une désescalade concrète et durable. Pour cela, des négociations diplomatiques sincères entre la RDC et le Rwanda seront incontournables. Une solution politique équilibrée devra intégrer non seulement le retrait des rebelles, mais également répondre aux préoccupations sécuritaires légitimes du Rwanda, notamment concernant la présence des FDLR en RDC.
En définitive, si Félix Tshisekedi a réussi à mobiliser la communauté internationale avec succès, le véritable enjeu est désormais la mise en œuvre effective d’une paix durable dans les provinces meurtries du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. L’avenir de la stabilité dans la région des Grands Lacs dépendra donc des prochaines étapes diplomatiques et sécuritaires. Le succès diplomatique actuel n’est qu’une étape vers une paix durable et solide, à laquelle tous les acteurs régionaux et internationaux devront sincèrement contribuer. Félix Tshisekedi a franchi un cap diplomatique majeur, mais le véritable défi reste la construction effective d’une paix durable pour l’Est de la République démocratique du Congo.