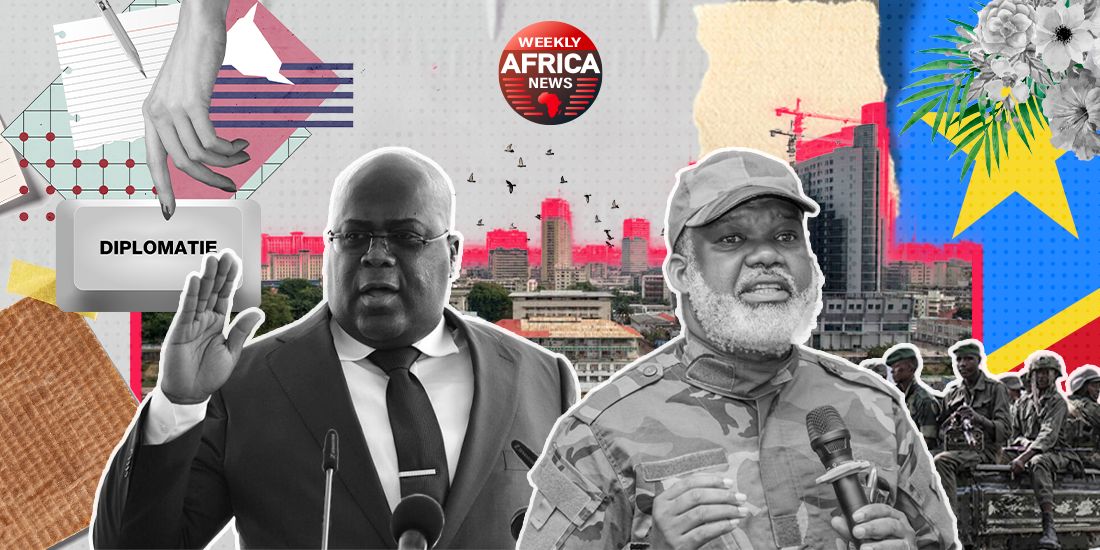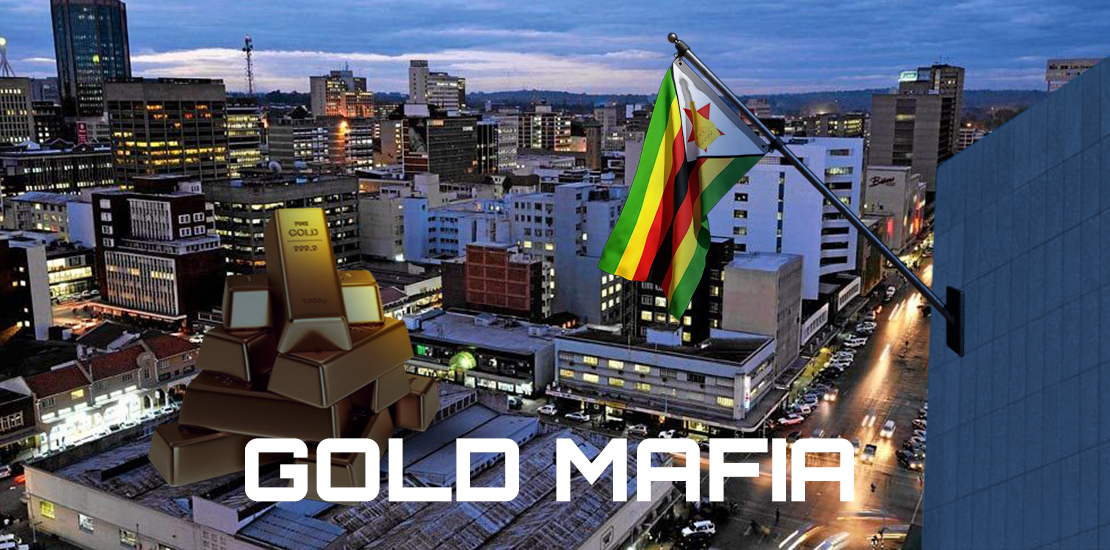Agrobusiness au Sénégal : Pourquoi les promesses de Faye et Sonko peinent à convaincre ?
Les relations entre la France et l’Algérie, marquées par une histoire tumultueuse, traversent actuellement une crise diplomatique majeure. Cette situation, exacerbée par des divergences sur le Sahara et des tensions migratoires, révèle les failles d’une gouvernance algérienne qui instrumentalise le passé colonial pour masquer ses propres défaillances.
Depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962, les liens entre Paris et Alger ont oscillé entre coopération et confrontation. Les accords d’Évian, qui ont mis fin à la guerre d’Algérie, ont posé les bases d’une relation complexe, mêlant interdépendance économique et mémoires conflictuelles. Les décennies suivantes ont été ponctuées de rapprochements et de crises, souvent alimentées par des enjeux mémoriels et des considérations géopolitiques.
La récente détérioration des relations bilatérales trouve son origine dans plusieurs facteurs. Tout d’abord, la question du Sahara, territoire disputé entre le Maroc et le Front Polisario, soutenu par l’Algérie, est au cœur des tensions. La France, historiquement neutre sur ce dossier, a récemment modifié sa position, provoquant l’ire d’Alger.
En juillet 2024, le président français Emmanuel Macron a adressé une lettre au roi Mohammed VI du Maroc, affirmant que le plan d’autonomie marocain constituait la « seule base » pour résoudre le conflit au Sahara. Cette prise de position, confirmée lors d’une visite officielle au Maroc en octobre 2024, a marqué un tournant dans la diplomatie française. Paris a ainsi reconnu la souveraineté marocaine sur ce territoire, s’alignant sur la position de Rabat et s’éloignant de la neutralité affichée jusqu’alors.
Cette décision a été perçue par Alger comme une trahison et une atteinte à ses intérêts stratégiques. En réaction, l’Algérie a rappelé son ambassadeur en France et a adopté une posture diplomatique plus agressive, accusant Paris de partialité et de mépris envers le droit international.
Parallèlement, les questions migratoires ont exacerbé les tensions. La France reproche à l’Algérie son manque de coopération dans la réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière. Un incident emblématique est survenu en février 2025, lorsqu’un influenceur algérien, expulsé de France pour incitation à la violence, a été refoulé par les autorités algériennes et renvoyé en France. Cet épisode a été interprété par Paris comme une tentative d’humiliation et a conduit à des menaces de révision des accords migratoires bilatéraux.
Le Premier ministre français, François Bayrou, a annoncé que la France pourrait remettre en cause l’accord migratoire de 1968 si l’Algérie ne coopérait pas davantage dans la réadmission de ses ressortissants. Cette escalade témoigne de la dégradation profonde des relations entre les deux pays.
Au-delà des différends diplomatiques, la crise actuelle met en lumière les faiblesses internes de la gouvernance algérienne. Depuis des décennies, le régime algérien, dominé par une élite politico-militaire, peine à répondre aux aspirations démocratiques et économiques de sa population. Face à ces défis, les autorités ont souvent recours à une rhétorique nationaliste, exploitant le passé colonial pour détourner l’attention des problèmes internes.
L’instrumentalisation de la mémoire coloniale et des tensions avec la France sert ainsi de levier pour renforcer la légitimité du pouvoir en place. En accusant Paris de néocolonialisme et en ravivant les blessures du passé, le régime algérien tente de fédérer la population autour d’un ennemi extérieur, masquant ainsi ses propres défaillances.
Cependant, cette stratégie comporte des risques. En se focalisant sur des conflits extérieurs, l’Algérie s’isole diplomatiquement et compromet ses relations avec des partenaires clés. De plus, la jeunesse algérienne, de plus en plus connectée et informée, est moins réceptive à cette rhétorique et aspire à des changements concrets sur le plan économique et social.
La détention de figures critiques, comme l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, arrêté en novembre 2024, illustre la répression croissante du régime envers les voix dissidentes. Ces actions, couplées à une diplomatie agressive, risquent de fragiliser davantage la position de l’Algérie sur la scène internationale.
La crise actuelle entre la France et l’Algérie semble s’inscrire dans une impasse. D’un côté, Paris cherche à affirmer sa position sur des dossiers régionaux sensibles, tout en exigeant une coopération accrue en matière migratoire. De l’autre, Alger, en proie à des défis internes majeurs, utilise la confrontation avec la France comme un outil de consolidation du pouvoir.
Cette dynamique conflictuelle pourrait avoir des conséquences néfastes pour les deux pays. Pour la France, la détérioration des relations avec l’Algérie pourrait affecter ses intérêts économiques et sécuritaires dans la région. Pour l’Algérie, l’isolement diplomatique et la focalisation sur des conflits extérieurs risquent d’aggraver les problèmes internes et de retarder les réformes nécessaires.
La crise actuelle entre la France et l’Algérie est le reflet d’une relation complexe, marquée par un passé colonial douloureux et des intérêts géopolitiques divergents. Si les différends sur le Sahara et les questions migratoires sont les déclencheurs immédiats de cette crise, les causes profondes résident dans la gouvernance algérienne, qui instrumentalise les tensions avec la France pour masquer ses propres échecs. Pour sortir de cette impasse, un dialogue franc et constructif est nécessaire, impliquant une remise en question des stratégies actuelles et une volonté de dépasser les rancœurs historiques au profit d’une coopération mutuellement bénéfique.